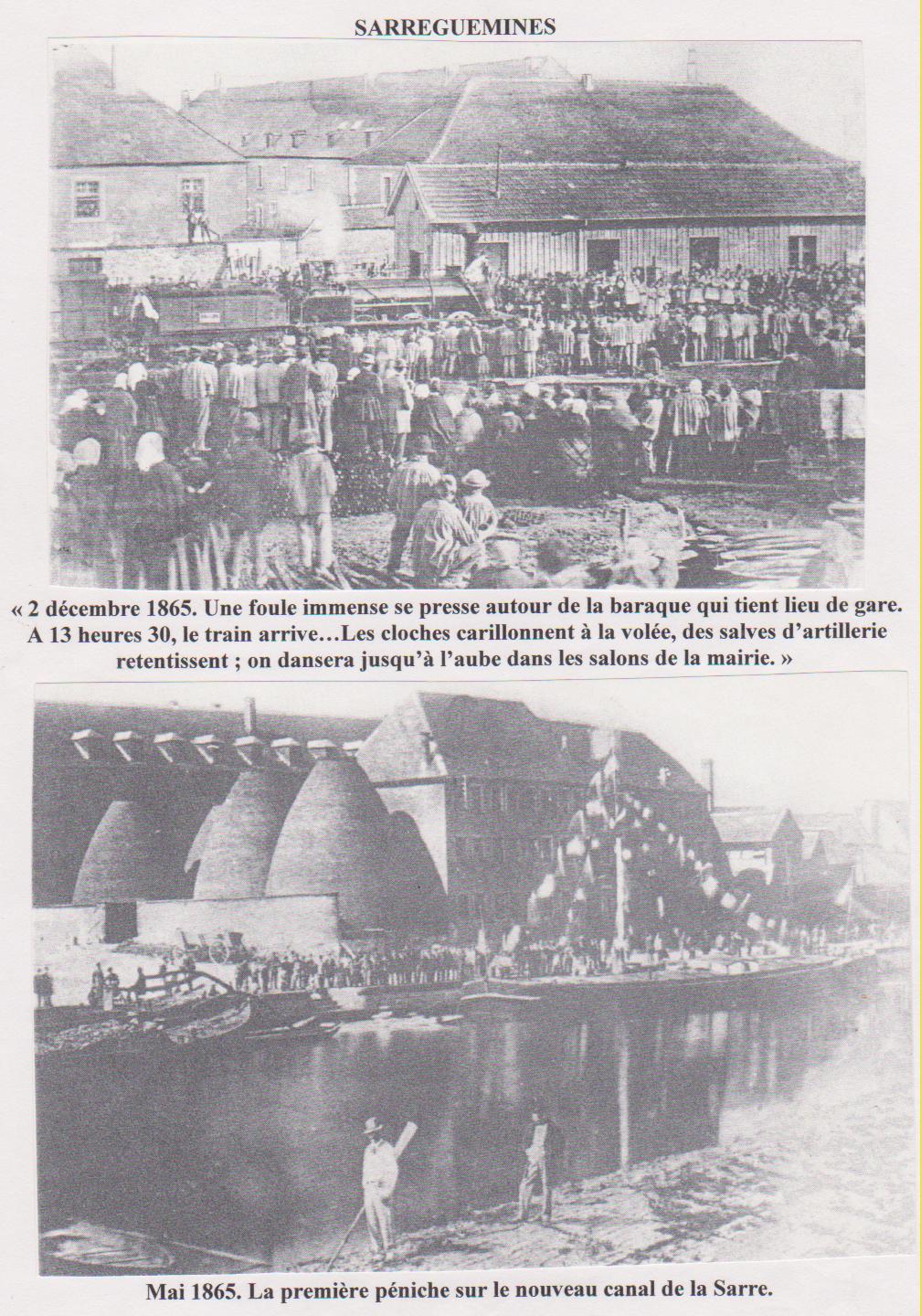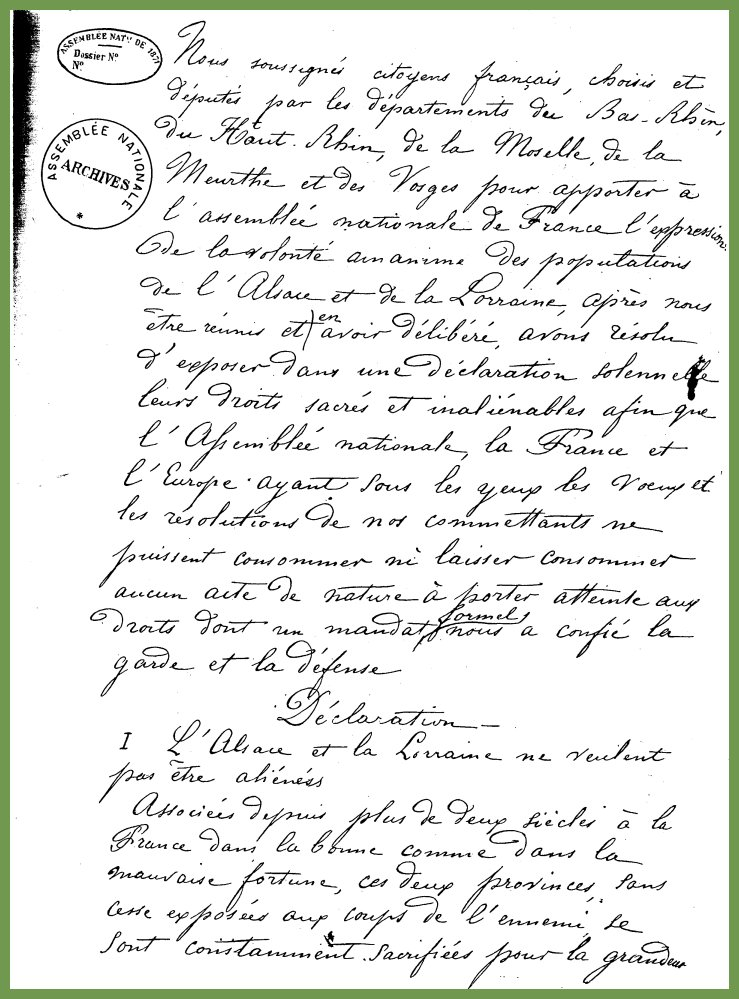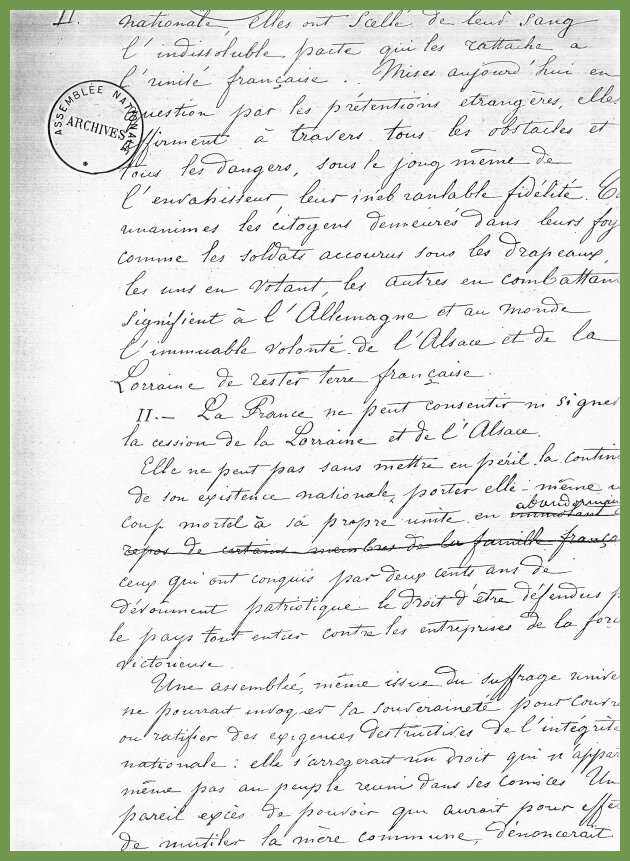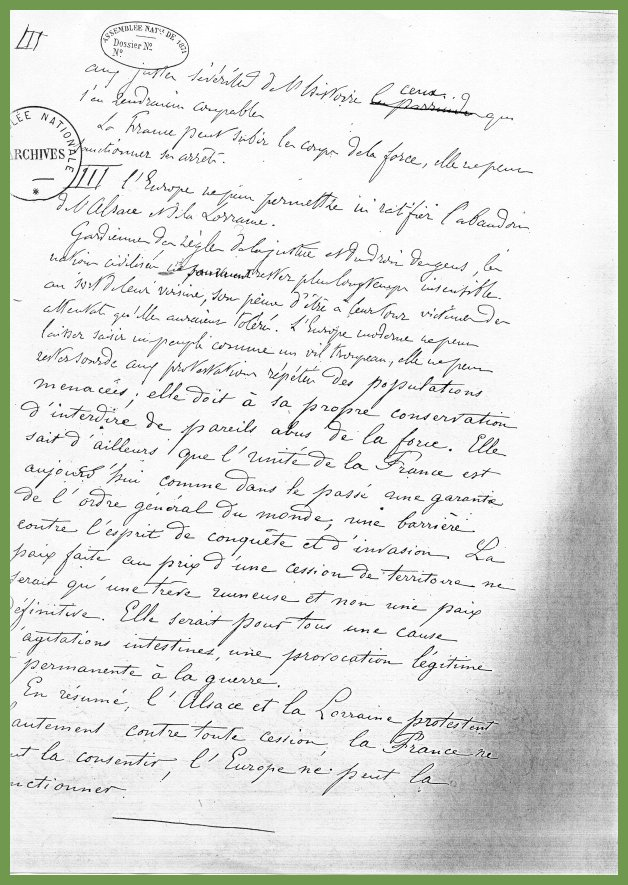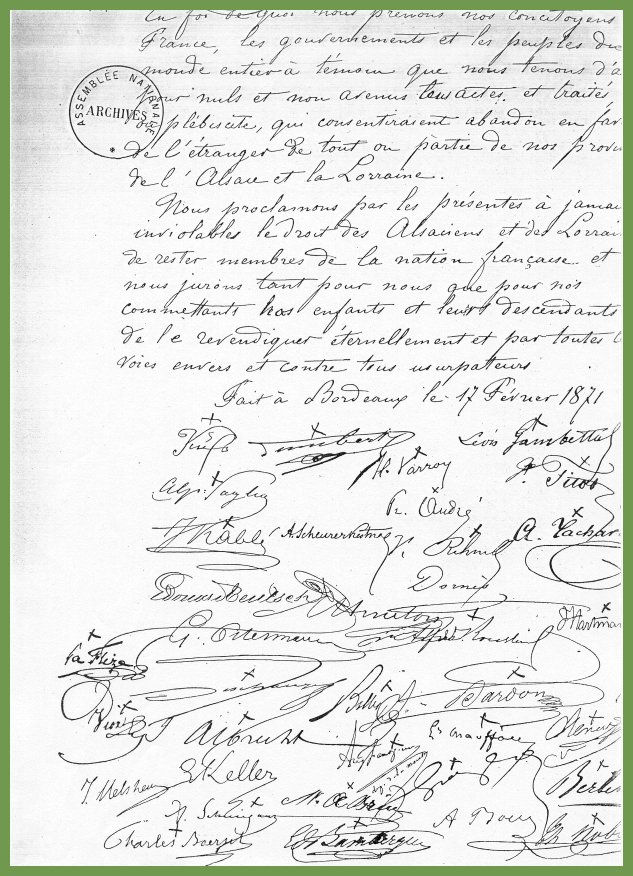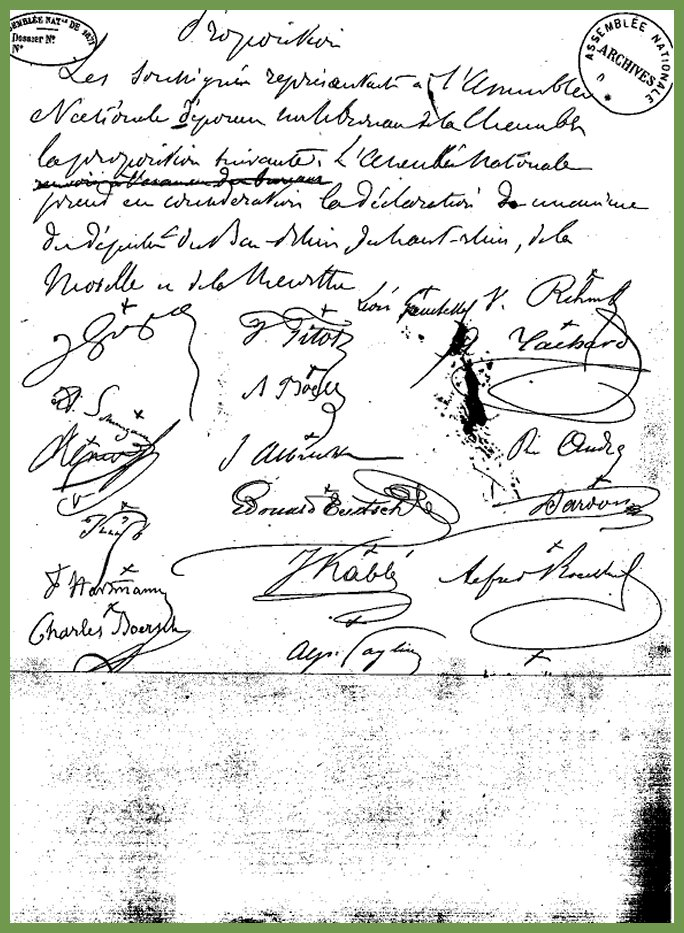LE LORRAIN, OU D’UNE GUERRE A L’AUTRE
PREMIÈRE ÉPOQUE.
Le grand-père lui avait raconté plein d’histoires sur les troupes du Petit Tondu qui étaient passées par Sarreguemines lors des campagnes de l’Empereur Napoléon 1er. Mais ce matin-là, ce sont d’autres soldats qui passaient dans les rues, redoutés de tous pour leur sauvagerie : les Uhlans. Le bruit des sabots des chevaux sur les pavés avait fait fuir les habitants et les chiens. La ville semblait vide. Franz était sur le pas de sa porte, rue des Vosges, et observait ces cavaliers commandés par des hurlements qui couvraient le bruit des chevaux. La caserne, proche, était en pleine activité.
Les anciens racontaient que la guerre était perdue, que Napoléon III était prisonnier et que nous allions tous devenir prussiens. L’Allemagne allait annexer l’Alsace et une grande partie de la Lorraine. Le père, très inquiet, pensait que son fils allait devenir un soldat enrôlé de force dans l’armée prussienne et qu’il allait falloir fuir vers la France. Ses deux petites sœurs ne risquaient rien. En cette année 1871, avec ses dix neuf ans, Franz ne songe à rien d’autre qu’à sa vie de garçon dans cette petite ville de l’Est de la France. Il avait toujours entendu parler de la guerre ; depuis cinq cents ans, la France, l’Empire germanique, voire la Bourgogne se disputaient ce coin de terre, faisant plus de morts que les famines et la peste. Une fois de plus, les frontaliers allaient payer le prix fort.
…………….
Depuis huit ans, Franz travaille à la faïencerie, comme son père d’ailleurs. Beau garçon avec ses cheveux blonds légèrement bouclés, des yeux d’un bleu très clair, il est de grande taille comme tous les hommes de sa famille. Il gagne bien sa vie, et, célibataire vivant chez ses parents, il n’a que peu de besoins et participe largement à la vie du foyer. Chaque année, la grande foire de la ville attire camelots, commerces ambulants, montreurs d’ours et manèges fantastiques. La « kirb » dure quinze jours et Sarreguemines est en liesse. Les « économies » de l’année sont investies pour faire la fête ; bals, bières, manèges…c’est la récompense d’une année de labeur.
Un groupe de Uhlans passe au galop, l’un d’eux fait mine d’embrocher notre jeune rêveur avec sa lance et s’en va en éclatant de rire avec ses camarades. « Mon père a raison, il faut que je parte d’ici. »
Malgré la présence des Allemands, les informations circulent. Ceux qui ne désirent pas devenir allemand, peuvent quitter les régions annexées et rejoindre la France. Franz décide de partir. Mais comme pour un combat retardateur, il trouve mille problèmes à régler, la mère est en larmes, les sœurs ne comprennent pas ce qui se trame, le père est fier et inquiet à la fois. Il expliquera au chef d’équipe de la fabrique pourquoi Franz est absent…Le lundi suivant, à l’heure où les faïenciers prennent leur service, Franz est déjà dans le train qui doit le mener vers Metz. Le train…Il se souvient très bien de l’arrivée du premier train dans la ville ; c’était en décembre 1865, un peu avant Noël. Toute la ville était là, la gare provisoire se trouvait à trois cents mètres de la maison, rue des Vosges. C’était l’année des grands travaux du canal et les premières péniches passaient l’écluse du Moulin, pavoisées de drapeaux multicolores. Les cahots du train ramènent Franz à la réalité. De petits villages défilent derrière les vitres du wagon, cachés de temps en temps par une épaisse fumée noire que crache douloureusement le monstre à vapeur qui le tire vers l’avant. Soudain, son ventre se serre, il ne sait plus si c’est la faim, la soif, l’angoisse ou la peur.
Il s’éloigne de son pays natal qu’il n’avait jamais quitté, il se rend compte qu’il est seul avec les dernières recommandations de son père et les cinq francs qu’il lui a mis dans la poche au moment du départ. « Evite de les dépenser, a-t-il dit, offre tes services pour gagner un repas et tes sous dureront longtemps. » Une bonne recommandation et trois jours de vivres pour le voyage. Franz est devenu subitement adulte.
Il est midi quand le train arrive enfin à destination. Le calme subit après l’arrêt en gare inquiète un peu le jeune Franz ; il a l’impression que son corps tressaute encore sur les rails et qu’il est toujours en mouvement. Pour lui c’est le terminus de son billet, mais le voyage, lui, ne fait que commencer. Sur le quai, à la sortie de cette gare en pleine construction, sur la grande place, partout des soldats ou des policiers, il ne sait pas trop, leurs uniformes lui sont inconnus. Méfiant, il se dirige vers un grand parc qu’il devine derrière une longue enfilade de grilles en fer forgé. Sous des arbres, sans doute centenaires, il s’installe sur un banc pour manger un morceau de lard et de pain, ce voyage lui a creusé l’estomac, à moins que son inquiétude…Dans la même allée, sur un banc un peu plus loin, un jeune homme l’observe. Plusieurs fois leurs regards se croisent et, au bout d’une petite heure de ce manège, le jeune homme se lève et se dirige vers Franz.
– Salut ! Je m’appelle Auguste Muller… je quitte mon pays pour aller en France, débite le jeune homme sans reprendre sa respiration.
– Salut ! Mon nom est Franz Rheinhardt, je viens de Sarreguemines ; c’est quoi ton pays ?
– Bitche…
La crainte qu’éprouvent les deux jeunes gens disparaît aussitôt.
– Nous sommes voisins alors. Comment s’est passée l’arrivée des Prussiens chez-toi ?
– Il y avait de violents combats, la Citadelle ne voulait pas se rendre, et les Allemands, nerveux, se sont vengés sur la population. Il y a eu des morts. Tous les jeunes ont fui la région.
– …
Le nouveau venu a une bonne tête de moins que Franz, large d’épaules, il semble robuste. Ses yeux noirs, grands ouverts lui donnent un air d’étonnement permanent.
Franz qui va rompre le petit silence qui s’installe.
– Tu connais quelqu’un à l’intérieur ? (C’est ainsi que les frontaliers appellent les Français habitants forcément plus au Sud : les Français de l’intérieur).
– Non ! Mais mon père a eu un renseignement à la mairie, il faut se rendre dans un camp militaire à Mailly-le-Camp… C’est en Champagne.
Grande interrogation chez le jeune Franz, ces noms de villes dont il n’a jamais entendu parler et qui lui semblent à l’autre bout de la planète.
– Je ne sais pas du tout où ça se trouve, va falloir se renseigner suggère Franz, persuadé désormais qu’ils feront route ensemble.
Pendant un très long moment, nos deux compères se taisent. Le cerveau en ébullition, des milliers de questions cherchent une réponse. Un moment, la tentation de retourner chez leurs parents est très forte, puis l’instinct de survie rappelle la présence des Allemands et la réalité de la guerre. Il faut trouver un moyen de transport, de la nourriture, un endroit pour dormir…De peur de se perdre, nos deux compagnons hésitent à s’éloigner de la gare, seul point de repère dans ce pays inconnu. Et puis la nuit va bientôt tomber, le temps est doux, mais une nuit sur un banc public ce n’est pas l’idéal. Il faut trouver une solution.
La solution arrive à pied, un balluchon sur l’épaule. L’homme avance à pas lents dans l’allée. La quarantaine sans doute, peut-être un peu plus, sa silhouette se détache à contre-jour sur le fond du parc. Ses larges épaules et sa casquette haute lui donnent une taille supplémentaire. Au fur et à mesure que l’homme se rapproche du banc, ses traits deviennent plus nets. C’est son regard qui frappe en premier ; deux grands yeux noirs, surmontés d’épais sourcils, percent l’atmosphère et semblent d’une grande mobilité, scrutant le moindre détail. De superbes rouflaquettes barrent ses joues et une moustache fournie recouvre ses lèvres. Son teint halé est celui d’un homme vivant au grand air. Une espèce de redingote grise sur ses épaules s’arrête à mi-cuisses pour laisser apparaître des jambes robustes dans des guêtres et des chaussures de marche comme ceux des soldats.
Son regard se porte sur les deux lascars en pleine méditation. A quelques pas du banc des deux inquiets, il s’arrête, toise les « suspects » d’un regard à la fois dur et rassurant.
– Alors les jeunes ! On cherche à faire un mauvais coup dans le parc ? … Vous êtes muets ou quoi ?
Comme deux écoliers, ils lancent ensemble un « Bonjour monsieur ! » timide, surpris. C’est Auguste qui se manifeste le premier.
– Nous venons d’arriver et nous sommes un peu perdus. Je m’appelle Franz et lui c’est Auguste, nous avons pris le chemin de fer pour fuir les Prussiens.
– Evidemment vous ne savez pas où dormir ?
– Euh ! Non.
– Bien ! Je vais vous montrer comment s’abriter à moindre frais ; suivez-moi !
Le jour tombe, ce qui aide à prendre la décision qui convient à la situation du moment et les deux jeunes gens suivent le nouveau venu sans hésitation. Il a l’air de connaître les lieux et marche d’un pas sûr en direction d’une maisonnette, là-bas, au fond du parc. Personne dans les parages, le regard balaie les alentours pour tenter de découvrir une présence suspecte.
– Il faut me dire Jean, c’est mon nom. Nous allons dormir dans la serre qui se trouve derrière la petite maison. Il y a une remise pour les outils assez grande pour nous trois, c’est presque confortable, dit-il en riant. Il ne faut pas rester dans la serre, c’est bon pour un mal de crâne avec toutes ces plantes.
– Monsieur Jean…
– Jean, ça ira…
– …Jean, si quelqu’un venait ? Lance Franz.
– Personne depuis trois jours que je suis là !
Une très longue verrière apparaît derrière une ligne de végétation. Au fond, une partie en bois, sans doute la remise à outils. Jean pousse une petite porte et les trois compères pénètrent dans ce qui sera l’hôtel de nos voyageurs. Il semble vraiment être chez-lui et saisit une bougie qui se trouve sur une étagère, active une mèche d’amadou pour enflammer un petit bout de papier qui lui sert ensuite à allumer la bougie. Les deux Lorrains en vadrouille l’observent attentivement sans dire un mot. La lumière faible et dansante de la bougie, donne un aspect lugubre à cette petite pièce où les formes d’un râteau ou d’une faux prennent des contours inquiétants.
– Franz, tu te mets là …et toi Auguste, tu mets la brouette debout contre la paroi, bien calée, et tu t’installes avec ton barda.
Chacun s’exécute rapidement.
– Ca fait plusieurs jours que je dors ici. J’ai fait une longue route depuis Paris et mes pieds ont besoin de se refaire.
– Paris…Mais c’est loin, mon père m’a dit que c’est grand comme un département et que c’est même une capitale.
Gros rire de Jean.
– Vous n’êtes jamais sortis de votre trou à rats. J’ai l’impression que vous n’avez jamais traîné vos guêtres nulle part.
Les deux Lorrains, un peu gênés, s’affairent dans un simulacre de rangement en déplaçant plusieurs fois leur petit sac à dos, déballant, emballant, pliant…Jean, se rend compte qu’il les a un peu rudoyés et pour détendre l’atmosphère il propose de se restaurer.
– Il me reste un gros morceau de pain et du boudin que j’ai pris au marché ce matin, il y en aura bien pour trois.
– J’ai du lard et du pain, enchaîne Franz.
– Moi, il ne me reste qu’un bout de fromage dit Auguste…
– A nous trois, nous avons de quoi faire un festin de roi, reprend Jean.
La bougie se consume à une allure vive, fouillant dans son sac, Jean en sort une nouvelle tout en expliquant que son lieu d’approvisionnement était l’église qui se trouve un peu plus loin. Braves paroissiens !
Le début du repas se passe en silence, puis, petit à petit, un dialogue s’installe entre les trois hommes. Jean tend une gourde à Auguste…
– Va nous chercher à boire. Derrière l’abri il y a une fontaine avec une pompe ; près d’une serre il y a toujours de l’eau.
Auguste s’exécute et sort de l’abri. Dehors il fait nuit maintenant. La suite du repas se déroule, ponctué par quelques plaisanteries et quelques rires. Le moral est bon, l’espoir prend le pas sur l’inquiétude, l’estomac ne se manifeste plus. Tout va bien.
Après un long moment, Jean propose de s’installer pour la nuit et d’éteindre la bougie. Une discussion s’engage alors dans l’obscurité entre les trois hommes.
– Tu faisais quoi à Paris, lance subitement Auguste à l’adresse de Jean.
– Paris, une grande ville comme ça, c’est sûrement bien, relance Franz.
– …
– Oui, c’est bien quand on ne se bat pas dans les rues, quand il y a du travail pour tout le monde…
– Comment ça ? Répondent presque en chœur les deux jeunes Lorrains.
– C’est une longue histoire… Quand j’ai eu l’âge d’être conscrit, j’ai tiré un mauvais numéro et j’ai dû partir aux armées. Il y avait la guerre au Maroc et en Afrique du Nord, c’était en quarante…Cinq ans que je suis resté dans le bled avec le Père Bugeaud. Je suis revenu quelques mois après la victoire d’Isly où on a mis la pâtée à Abd el Kader, en quarante-quatre. A Marseille, j’ai été libéré et je suis revenu à Paris où mon père avait un atelier de charpentier. Je n’ai rien retrouvé ; mon père est mort, ma mère partie avec un autre bonhomme, notre quartier avait disparu, des grands boulevards et plus de maison. Sept années que l’armée m’a prises, plus de boulot, plus rien. Alors, j’ai vécu comme j’ai pu, me déplaçant souvent d’un chantier à l’autre, faisant n’importe quoi. Il y avait de plus en plus de misère, de moins en moins de travail. J’ai repris la route pour sillonner la France dans tous les sens et en fonction des saisons et des récoltes j’ai fait les mille métiers des fermes et des champs. Puis, je suis revenu à Paris il y a trois ans. Une très mauvaise idée que j’ai eue là.
Jean se lance dans une longue tirade, une leçon de chose et d’histoire sur des événements dont, ni Franz, ni Auguste n’avaient entendu parler. La voix du narrateur vibre parfois, sans doute d’émotion, puis reprend avec assurance. Dans un silence quasi religieux, ils écoutent dans le noir de leur abri, les affres de la vie de l’homme.
– En septembre dernier, l’Empereur a perdu la guerre, l’ennemi est aux portes de Paris. La capitale organise alors sa défense et comme en 1792, c’est la levée en masse des hommes. Paris devient un camp retranché, ancien soldat, je me retrouve dans la Garde nationale avec des gars qui ne connaissent rien aux armes. Vu mon expérience, ils me nomment sergent-major et je dois instruire ce petit monde. Comme disait le général Trochu, « J’ai beaucoup d’hommes mais peu de soldats.» Bref ! Pour trente sous par jour et à manger, je fais mon devoir de Français. Fin septembre, les Allemands attaquent ; c’est la débandade, Paris est complètement isolée. L’hiver est déjà très froid et les hommes sont mal équipés, de plus, beaucoup ont des vieux fusils dit « fusil à tabatière.» Puis en janvier, les Allemands ont commencé à bombarder les quartiers sud, ça a duré plus de trois semaines. Mais le problème le plus grave c’était la nourriture. Personne ne pouvait plus rentrer ou sortir de Paris, donc pas d’approvisionnement, il ne restait que des rats, des chiens et des chats, même les éléphants du Jardin d’acclimatation sont passés par nos gamelles.
– Des éléphants ! …S’exclame Auguste.
– Oui, oui, tous les animaux du Jardin y sont passés. Puis, fin janvier, des civils et des Gardes nationaux ont manifesté devant l’Hôtel de ville et des coups de feu ont été tirés. Le 28 janvier, je me souviens, c’était l’Armistice ; un vrai choc pour nous. Au mois de mars, je quitte la Garde qui s’agite politiquement. Les chefs de bataillons sont élus et pas toujours très militaires mais plutôt du côté de l’Internationale ; des révolutionnaires quoi. Puis la solde a été supprimée et il faut bien manger. A partir de la mi-mars, c’est l’horreur. C’est le début d’une période qu’ils appellent la Commune. Une neige fondante était tombée toute la nuit et avec les premiers rayons du soleil, tout a disparu. Le printemps était un peu en avance sur le calendrier. Pendant 72 jours exactement, le soleil de ce maudit printemps va se refléter sur le sang de milliers de Parisiens. Ils pourront toujours chanter leur chanson « Mais il est bien court le temps des cerises… » Moi, j’ai trouvé ça très long. Partout, il y avait des barricades, on fusille, Paris était ravagée par des combats de rues, des incendies ; même l’Hôtel de ville a brûlé. C’était une folie furieuse, meurtrière. Des Français tuent des Français. On fusille tous ceux qui portent un vêtement qui a une vague ressemblance avec un uniforme. On fusille des femmes parce qu’elles possèdent sur elles des allumettes. On fusille les blessés dans les hôpitaux, les femmes sur le pas de leur porte ou la porteuse de pain. On fusille pour fusiller. Même au Maroc je n’avais jamais vu ça. Alors j’ai quitté la capitale et me voilà.
– …
Le silence qui suit ce monologue, pèse dans l’abri de fortune. Lourd de souvenirs pour l’un, fascinant pour les autres, personne ne dit plus un mot.
– …
– Bien ! Il faut dormir maintenant.
Le lendemain matin.
Une petite lueur pénètre dans la remise et le bruit feutré des corps endoloris qui réagissent à l’inconfort de la nuit et à la fraîcheur matinale, réveille les trois hommes. Tout en se chaussant, Jean est le premier à parler.
– J’ai réfléchi cette nuit au moyen de vous aider. La discussion d’hier soir m’a fait comprendre que vous n’êtes pas encore de taille à vous débrouiller pour un voyage pareil…Nous allons d’abord trouver quelque chose de chaud à avaler et je vous expliquerai mon idée.
Une petite toilette de chat à la fontaine de la serre, quelques instants pour refaire leur barda, en quelques minutes les trois hommes sont prêts à partir.
– Où allons-nous maintenant ? Dit Franz interrogateur.
– Au marché couvert. C’est à une petite demi-heure de marche. Nous trouverons ce qu’il nous faut.
Franz ferme la marche, devant lui, Auguste paraît un nain à côté de l’imposante masse de Jean. La cadence imposée par ce dernier oblige Auguste, tous les quelques mètres, à courir un bref instant pour rester dans les pas de Jean.
A l’angle d’une rue ils découvrent une place avec en son centre, une grande construction avec des vitraux, comme sur les façades des églises, et des personnages sculptés. Une immense entrée fait face à l’une des nombreuses rues qui convergent vers cet endroit.
– C’est là ! Dit Jean. C’est le marché couvert.
Une activité fébrile règne autour du marché, des chevaux tirant des charrettes, d’autres, arrivées sans doute avant l’aube, sont déchargées par une multitude de bras dans un va et vient incessant, des chevaux qui hennissent, des cris, des plaisanteries, des rires…L’odeur des légumes frais se mélange avec celle, plus acide, des animaux de basses-cours. A l’intérieur, des étals de boucher, des vendeurs de vin avec des barriques dépassant la taille d’un homme, un fromager aligne sa marchandise avec un très grand soin sur un tissu blanc. Une jeune fleuriste présente les premières fleurs du printemps dans des baquets tout en chantonnant d’une voix agréable
L’estomac de Franz se rebelle à la vision et au mélange des odeurs de pain frais, de charcuterie et de fromage confondus. A côté d’un brasero, un homme en blouse propose du lait chaud. C’est là que Jean s’arrête.
– Trois bols bien chauds, mon brave !
Le lait fumant est particulièrement apprécié par Auguste après l’effort qu’il vient de fournir pour suivre le pas rapide des deux grands qui l’accompagnent.
– Ca va mieux hein ! Dit Jean. Ne bougez pas d’ici, je vais nous trouver un boulot pour la journée, histoire de gagner notre croûte.
Il s’éloigne, puis disparaît dans la foule.
Le brouhaha qui règne autour de nos deux compères est si intense que, ni Franz, ni Auguste ne tentent d’engager une conversation. Puis, comme par enchantement, presque un silence. La porte s’ouvre, les énormes battants, poussés par deux hommes, laissent apparaître une grande gueule noire où une foule de gens s’engouffre à une vitesse incroyable, il semble que les personnes qui composent cette foule, glissent sur des patins à glace comme dans le pays de Franz, quand la Sarre est gelée. Le bruit reprend, mais cette fois ce sont les marchands qui proposent leurs produits aux acheteurs. Sorti on ne sait d’où, Jean se retrouve devant les deux jeunes gens, un grand sourire étale sa moustache sur toute la largeur de son visage.
– Au boulot les jeunes ! Il y a du travail pour tout le monde.
Jean fait la répartition des tâches, il est redevenu le sergent-major et fixe dans le détail le travail de chacun. Récupération des outils, lieux des travaux en question, tenue, temps de repos, rendez-vous de fin de journée…Le corps bien droit, les talons joints et le discours simple et tranchant du soldat, Jean impressionne les deux jeunes Lorrains qui, pour un peu, se mettraient au garde à vous. Pour Auguste, ce sera autour des halles ; récupérer le crottin des chevaux pour le mettre dans les quatre tombereaux, un à chaque coin du bâtiment. Franz, quant à lui, c’est chez un boucher qu’il va exercer ses « talents.» Sa « mission » ; charrier des quartiers de viandes pour approvisionner les étals des bouchers et vider les baquets emplis des chutes et des ossements. Le sergent-major, pardon ! Jean, leur donne rendez-vous pour quatre heures de l’après-midi car lui, a une chose importante à régler.
Franz et Auguste ont un grand sourire quand ils voient leur compagnon disparaître… avec la boulangère et ses paniers de pains.
La journée se passe comme les « ordres » le prévoyaient. Auguste fait pour la quatorzième fois le tour du marché couvert, les quatre tombereaux se remplissent et son dos faiblit au fil du temps. Il y a des chevaux dans la fermette de son père, cinq pour être précis, le nettoyage des stalles est, de loin, moins pénible. Il pense avoir fait des centaines de lieues depuis le début de la journée, ses pieds sont gonflés de fatigue, son dos est comme roué de coups, une douleur.
Les pièces de bœufs sont lourdes pour Franz qui n’a pas l’habitude de ce mode de transport. A la fabrique, il portait les planches de vaisselles peintes par les femmes aux établis des couleurs. Elles étaient alignées derrière leur table de travail, avec des pinceaux et des pots de peintures multicolores et appliquaient avec art et un soin méticuleux, des motifs sur la vaisselle avant la cuisson. Son rôle était de transporter sur l’épaule, à l’aide de grandes planches, les assiettes et plats, au bout de la travée dans les wagonnets qui partaient ensuite à la cuisson. Quelquefois les jeunes filles lui faisaient des petites farces en mettant de la peinture à l’endroit où il saisissait la planche. Il grognait un peu pour la forme, mais il aimait beaucoup ces petits rires féminins. Vivement quatre heures. La pause de midi a été très courte, le temps de grignoter le bout de pain qui lui restait. Le client se fait plus rare au fur et à mesure que l’après-midi avance, une équipe d’une dizaine d’hommes avec de grands balais, fait son apparition. Depuis un moment déjà, les commerçants chargent les invendus dans leur charrette. Un gros bonhomme, sale, des cheveux gras de sueur et de crasse et des vêtements ne valant guère mieux, se plante devant le jeune Auguste.
– C’est toi qui as rempli les tombereaux ?
– Oui, monsieur !
– Bien ! Tu vas m’aider à charger ma charrette et je te paie.
Auguste suit le gros bonhomme et son attelage vers le premier tombereau. Là, l’homme dételle son percheron, descend deux grosses planches de la charrette, une corde, les deux planches sont placées de chaque côté et reposent, une extrémité sur l’attelage et l’autre au sol, faisant ainsi un chemin de roulage pour les tombereaux. Avec l’aide d’Auguste, il place un tombereau à l’arrière de la charrette dont il a solidement calé les roues avec des coins en bois. Le jeune Lorrain a compris la manœuvre, il met les planches bien en face des roues pendant que l’homme relie la corde entre le cheval et le tombereau.
– Tu guides bien sur les planches. Dit l’homme. Moi, je m’occupe du cheval.
Sans aucun problème, les quatre tombereaux sont hissés sur la charrette. L’homme a visiblement l’habitude de cet exercice, mais il souffle comme un soufflet de forge et transpire plus que son cheval. Il met la main dans une de ses poches pour en sortir des pièces.
– Tiens ! Voilà vingt sous, comme convenu. Salut !
Le gros personnage disparaît avec son percheron et son crottin, laissant Auguste perplexe. Il n’avait rien convenu avec personne.
Soudain, une frayeur l’envahit. Il regarde ses mains, ses vêtements, il a peur de ressembler au gros bonhomme et se précipite vers la fontaine pour se laver et remettre de l’ordre dans sa tenue. C’est à ce moment-là que Franz le rejoint.
– Mon pauvre Auguste ! J’ai failli ne pas te reconnaître. T’es tombé dans le tonneau ?
La remarque de Franz les fait rire tous les deux. Manque plus que Jean. Où peut-il bien être ?
Il arrive enfin. Ils le voient traversant la place avec son balluchon sur l’épaule, l’air satisfait de sa journée. Apparemment le Jean n’a pas travaillé au marché, on devine sous son bras gauche, une grosse miche de pain.
– Ah ! Vous voilà. J’ai de bonnes nouvelles pour vous. Je connais un boulanger qui va chercher sa farine demain matin, il vous fera une place sur sa carriole. Faudra l’aider à charger ses sacs et il vous mettra en contact avec un de ses amis pour continuer votre route. Pour ce soir nous dormirons dans la serre du parc. En route mauvaise troupe !
– Il faut prendre quelques provisions pour la route. S’exclame avec vigueur Auguste. De plus, je n’ai rien mangé de la journée.
– T’inquiète pas, dit Franz, Le boucher chez qui j’ai travaillé m’a donné du saucisson et de la terrine pour un régiment.
– Parfait ! Alors en route.
Le retour vers le parc se fait en silence. Le labeur de la journée a été rude et les deux jeunes gens sont vannés. Le bilan de la journée est très positif pourtant; pas de dépense d’argent, de la nourriture pour au-moins deux jours, un moyen de transport pour continuer leur route et quelques sous de gagnés. La rencontre avec Jean a été une chance. De plus, en une journée, leur expérience de la vie s’est enrichie de détails utiles qui leurs serviront à l’avenir. Depuis deux jours, Franz n’a rien mangé de chaud et c’est Jean qui, une fois de plus, va apporter la solution.
– Ce soir, repas chaud. J’ai une soupe dont vous me direz des nouvelles.
En effet, de son balluchon, qui semblait bien lourd, il extrait un poêlon, avec un couvercle solidement fixé par les nœuds d’un torchon, qu’il pose à côté de la miche de pain que le pauvre Auguste n’a pas quitté des yeux depuis le départ du marché couvert.
– Nous allons faire un feu pour réchauffer cette soupe, mais dehors pour ne pas enfumer la pièce.
En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, il ramasse quelques brindilles de paille dans la serre, quelques petits branchages, et, à l’abri derrière la porte de la remise, il allume une bougie avec sa technique habituelle.
– Et maintenant, feu !
A genoux, abrité par la porte, Jean enflamme les brindilles et bientôt de belles petites flammes éclairent son visage sur lequel on devine la satisfaction d’une œuvre réussie.
– Auguste ! Va chercher quatre gros cailloux. Pas plus épais que la longueur d’un doigt.
L’affamé s’exécute au pas de charge. Il va les trouver ces cailloux dans la minute qui suit, il ne faut pas faire attendre cette soupe. Le voici de retour avec sa trouvaille qui correspond parfaitement aux désirs de Jean. La mise en place sur le feu est immédiate.
– En attendant, mon petit Franz, tu nous fais goûter la terrine de ton charcutier.
Les premiers effluves dégagés par la soupe, enveloppent les narines des trois affamés en train de tartiner la terrine sur le pain frais. Le festin commence. Le seul bruit qui s’entend est celui des mandibules des trois hommes. Jean surveille son feu, y rajoute une petite branchette de temps en temps, soulève légèrement le couvercle, laissant échapper ainsi le fumet de leur repas qui chauffe doucement.
– Nous allons manger à tour de rôle, je vous passerai ma cuillère. Il faudra vous procurer couteau, fourchette et gamelle si vous voulez vivre au grand air. Conseille Jean.
Dès que le grand Jean a terminé de manger sa part, il tend le poêlon à Franz. Voyant les yeux d’Auguste qui plongent dans la soupe avec envie, Franz cède le poêlon à son nouvel ami qui le remercie d’un large sourire. Le repas se termine enfin, l’abondance après une journée de jeûne a fini par avoir raison de la résistance des deux plus jeunes. Sans y être invités, ils s’installent pour la nuit, aux emplacements désignés la veille. Jean éteint le feu en jetant l’eau de sa gourde sur les flammes.
– Debout ! C’est le moment de partir, le boulanger ne va pas vous attendre.
Cette voix venue de loin, en plein sommeil, surprend Franz et Auguste. Il leur semble que la nuit venait juste de débuter quelques instants plus tôt. La tête d’Auguste, ce matin-là, n’a rien d’une œuvre d’art. Les cheveux en bataille, une barbe noire marque son visage et ses yeux sont encore plus grands que d’habitude. Il est vrai que depuis trois jours le couteau de rasage n’a pas servi. Franz, blond, n’a pas ce problème ; d’ailleurs il n’a qu’un duvet léger sur le menton. Le barda, rapidement prêt, un à un les trois hommes se retrouvent dehors.
– En passant par le marché, nous boirons un bol de lait chaud. Le boulanger partira vers huit heures. Allez, en avant ! lance le grand Jean.
Le minutage du sergent-major est d’une précision sans faille. Le trajet, le lait chaud, l’arrivée à la boulangerie…Il est huit heures, le boulanger s’affaire autour de sa carriole et d’une magnifique jument grise pommelée. L’homme est de taille moyenne, maigre, le teint pâle, l’air fatigué. Il jette un regard vers les nouveaux venus, toise les deux jeunes.
– Bonjour !
– Bonjour ! C’est ça les deux paquets que je dois transporter ?
– Je te présente Franz et Auguste, les petits réfugiés dont je t’ai parlé.
– J’ai passé ma nuit au fournil pour préparer le pain de la journée. Ca me fera de la compagnie. Si le sommeil me prend, ils conduiront l’attelage.
Sur ces entrefaites, arrive la boulangère qu’ils avaient aperçue la veille. Elle est très belle, jeune et fine, son tablier bien serré à la taille et un fichu cachant une chevelure que l’on devine blonde. Elle est superbe avec son sourire.
– Salut les hommes ! Dit-elle. J’ai là-dedans de quoi satisfaire vos estomacs pour la journée.
Elle pose un panier dans la carriole. Auguste remarque deux bouteilles qui dépassent ainsi qu’une miche de pain semblable à celle que Jean avait hier. Le regard de la boulangère se pose sur ce dernier qui lui sourit discrètement. Les deux jeunes Lorrains comprennent que le départ qui s’annonce se fera sans l’ami Jean, qu’ils seront livrés à eux-mêmes pour la suite de ce voyage dans l’inconnu. En deux jours, nos deux compères ont appris beaucoup au contact de cet homme extraordinaire; ils s’en souviendront longtemps.
– Un devant, avec moi sur la banquette, l’autre à l’arrière. C’est le moment de partir si vous voulez arriver avant la nuit.
– Allez mauvaise troupe ! Bonne chance ! Ce sont les dernières paroles que leur adresse le brave Jean en ponctuant sa phrase par une bonne claque dans le dos des deux Lorrains sans voix.
Ils embarquent enfin dans la carriole, Franz est assis à l’arrière et regarde son ami, une grande tristesse dans les yeux.
– Hue ! Ma belle.
L’équipage s’éloigne au pas de la jument qui peine un peu au démarrage. Franz fait un signe de la main, puis un autre…
– Merci Jean !
Le vieux soldat et la belle boulangère regardent s’éloigner ces deux gamins que les événements de la vie ont lancés sur les routes. Un long moment le silence domine. Seul le bruit des pas puissants de la jument rythme le temps qui s’écoule et, lentement, ils roulent en direction de l’ouest. Franz ne se rend pas compte qu’il vient de quitter cette ville aux grandes rues bordées de vastes immeubles, de monuments à la gloire d’illustres personnages, d’églises… Il se trouve sur une route de campagne quand il revient à la réalité. C’est sans doute la voix du boulanger qui converse avec son ami Auguste, qui le ramène parmi les vivants.
– Avant cette fichue guerre, la ville était régulièrement approvisionnée en farine. Mon fournisseur habitait Gravelotte, mais en août dernier, le village et le plateau ont été canonnés par les Prussiens et les Français. Tout a été détruit, plus de moulin, plus de meunier. Maintenant je suis obligé d’aller jusqu’à Mars-la-Tour pour ma farine. Remarque, je fais le voyage en même temps pour des collègues, histoire de rentabiliser le transport.
– C’est loin d’ici ? S’inquiète Auguste.
– Faut cinq heures à ma jument pour faire le trajet à vide. Mais je fais une petite pose à l’ancien relais de poste.
Le soleil est au zénith quand notre équipage arrive à l’endroit de la pause. La carriole se range le long du mur et notre boulanger dételle sa jument. Une vieille femme sort d’une grange, le tablier replié dans ses mains ; elle ouvre légèrement le tissu et présente des œufs frais qu’elle propose à notre homme.
– …Suis preneur ! Je les prendrai demain matin à mon retour. Pour mes pâtisseries c’est ce qu’il me faut.
Auguste pour se rendre utile, fait boire la jument à l’aide d’un baquet qu’il a trouvé. Il accompagne la bête vers un pré tout proche et lui inspecte les sabots, un à un. La jument se laisse faire sans problème. Franz récupère le panier à provisions dans la carriole et cherche un coin pour manger et se reposer. Le boulanger qui avait disparu dans le relais de poste, réapparaît. Il fait le tour de sa carriole en inspectant les roues et l’essieu ; satisfait, il s’installe sur le banc de pierre, à l’ombre de la bâtisse.
– Et maintenant on mange !
Le festin de la belle boulangère apparaît au fond du panier. Outre les deux bouteilles de vin et une grosse miche de pain, une poule rôtie dresse ses deux pilons vers le ciel, l’odeur et la couleur de la peau de l’animal font frémir les narines des trois voyageurs. Quelques pommes d’une belle couleur verte, un saucisson sec, un énorme fromage carré et une assiette avec une demi-douzaine de pâtisseries. C’est Noël pour Auguste et Franz, ils ont l’impression que le dernier repas de ce genre remonte à une autre vie, quand ils vivaient auprès de leurs mères. Le boulanger fait le partage, Auguste remarque qu’il partage en quatre et son air étonné est saisi par le regard du boulanger.
– Eh oui ! Demain, au retour, j’ai un repas à faire…
– Ah oui ! Se désole Auguste.
Le repas terminé, le boulanger, dont ils ne connaissent toujours pas le nom, s’allonge sur le banc de pierre pour un petit somme.
– Monsieur, monsieur…Réveillez-vous…L’après-midi est déjà bien entamée.
En effet, le soleil commence à pencher vers le couchant et il ne faut plus perdre de temps maintenant. Auguste récupère la jument dans le pré et s’occupe à l’atteler à la carriole. Franz rassemble les sacs et le panier de provisions qu’il charge. Le boulanger a beaucoup de peine à se réveiller. Enfin ! Ils sont prêts.
– Hue ma belle !
La carriole s’ébranle sur le chemin.
Plus de deux heures se sont écoulées depuis le départ du relais de poste, l’inconfort de la route est aussi pénible que le travail au marché la veille. Le corps des deux adolescents n’est que douleur, une nuit de repos sera la bienvenue. Ils arrivent enfin chez le meunier. A la première rencontre avec ce personnage, aucun doute n’est permis, il est blanc de la tête aux pieds comme sa farine ; c’est bien le meunier.
– Salut la Boulange ! Les affaires vont bien, t’as embauché du monde ?
– Ah ! Ah ! Ah ! Du tout, ce sont des petits Lorrains qui ont quitté leur pays. Ils préfèrent un Empereur défait qu’un Roi de Prusse.
– Je suppose que tu vas passer la nuit dans la grange et que tu charges demain matin…
– Suppose bien la Farine ! Mes deux lascars chargeront pour moi avant de reprendre leur route. J’ai besoin de sommeil moi.
– Le père Bourru avec son mauvais caractère et sa vieille mule ne sera sans doute pas d’accord pour les prendre tes jeunes. Un obus de rouge le fera changer d’avis. Au fait, combien de sacs pour demain matin ?
– Vingt, ma jument n’en veut pas plus.
Chacun se prépare pour une nuit de sommeil grandement méritée. La grange est très vaste, le foin ne manque pas, pourtant il n’y a pas de chevaux ? Auguste pose la question au meunier.
– La guerre mon petit, la guerre. J’avais deux magnifiques brabançons et un grand mulet, les Prussiens me les ont pris, superbes mes bêtes et rudes à la tâche. Cinquante sacs dans la charrette ce n’était pas pour leur faire peur. Maintenant que le calme est revenu, va falloir que j’en achète deux autres.
Une voix de femme se fait entendre sur le seuil de la grange, petite voix douce, presque enfantine. L’épouse du meunier ? Sa fille ?
– Hé les hommes ! J’ai des gobelets et du vin qui fera partir la poussière de la route de vos gosiers. Et attention pour la nuit, ne me mettez pas le feu à la grange.
Puis, elle s’en va comme elle est venue, en courant d’air, sortie de nulle part pour disparaître dans la bâtisse qui semble être la demeure du couple. Auguste a dételé la jument et l’a fait rentrer dans une des stalles. Visiblement, il aime les chevaux et s’en occupe en connaisseur. Il bouchonne la bête un long moment, vérifie ensuite l’état de ses sabots et à l’aide d’un cure-sabots nettoie consciencieusement chaque patte de l’animal. Un baquet d’eau et du foin est mis à la disposition de la jument qui piaffe un petit instant, hennit et se met à manger. Satisfait, Auguste rejoint le petit groupe.
Franz a préparé deux emplacements pour la nuit. Une épaisseur de foin convenable, recouverte par les couvertures des anciens chevaux de la maison, va assurer une nuit confortable. La Boulange a ses habitudes, il s’est installé dans un coin de la grange qui est aménagé avec un châlit rempli de sacs de foin servant de matelas, un tabouret et une petite table. Une lanterne avec une grosse bougie est posée sur la table, le volet ouvert prête à être utilisée. Franz pose le panier à provisions sur la table et rajoute saucisson et terrine qu’il sort de son sac. Tout est prêt pour le repas du soir. Auguste arrive en bras de chemise, le boulanger qui vient d’allumer la lanterne est encore plus pâle que d’habitude, la lumière de la bougie lui donne un teint blafard et accentue la maigreur de son visage. Le repas se prend presque sans un mot, le nouveau compagnon est peu causant et les deux jeunes Lorrains n’insistent pas pour engager une conversation. La nuit se passe.
Aux premières lueurs du jour, un des battants de la porte de la grange s’ouvre violemment. C’est la petite femme dont on ne voit toujours pas le visage à contre-jour. Quelques poules giclent en courant ailes déployées et en caquetant bruyamment.
– Vous n’avez pas honte de dormir alors que le soleil est déjà haut perché…
Elle se met à fouiller dans le foin pour y trouver très rapidement quelques œufs fraîchement pondus et s’en va avec sa « récolte » délicatement posée dans le pli de son tablier. Doucement, les trois hommes se lèvent et rassemblent leurs affaires. La nuit de sommeil a redonné un air moins triste au boulanger qui se met à parler du travail de la journée. Préparation de l’attelage, chargement des sacs, trajet, heure de retour avant une nouvelle nuit dans son fournil, une longue journée s’annonce pour lui. Auguste cherche des œufs en retournant par brassée le foin ; il en trouve quatre encore chauds, donc frais du jour. Il en gobe un et propose à Franz d’en faire autant. Sûr, il a connu mieux au petit déjeuner, mais la journée s’annonce bien. Les deux jeunes gens attaquent de front leur tâche. Auguste sort la jument qui le suit docilement. En deux tours de mains, l’attelage est prêt. Franz qui a terminé de remettre en place couvertures et sacs, se dirige vers le meunier qu’il aperçoit de l’autre côté de la cour.
– Bonjour monsieur ! Où faut-il mettre la carriole pour charger ?
– Suis-moi mon garçon.
Dans le prolongement de la demeure, une remise où sont entreposés les sacs de farine. Franz devine que c’est un moulin à eau. Légèrement en hauteur, il aperçoit un mécanisme tournant avec une grande meule de pierre ; l’ensemble est actionné par une roue à aube qui plonge dans une cascade d’eau qu’il entend nettement maintenant.
– Les sacs vides là-bas, les sacs à charger sont ici. Vingt, et pas un de plus.
Franz fait signe à son ami qui arrive avec la jument, se range au ras de la porte et se hisse sur le plateau à l’arrière pour réceptionner les sacs. Les deux jeunes gens chargent en un temps record les vingt sacs de farine, à la grande satisfaction du boulanger. Le meunier qui les a observés, leur propose du travail pour la journée.
– J’ai deux cents sacs à descendre dans la remise. Si vous me faites ce travail, vous aurez un bon repas à midi. D’ailleurs le père Bourru n’arrivera pas avant.
L’affaire est faite et tous deux se mettent au travail séance tenante. Le boulanger vient récupérer son bien, vérifie son chargement et salue Franz et Auguste.
– Bonne chance les jeunes !
– Merci pour le transport. Si vous voyez Jean, remerciez-le encore pour nous.
La Boulange, dont ils ne connaîtront jamais le nom, s’en va sans se retourner, vers sa femme, son fournil et sa vie de tous les jours. Il s’endormira sans doute sur sa banquette, mais sa jument connaît la route.
La cadence diminue au fur et à mesure que le soleil grimpe dans le ciel. Chaque sac fait environ cent livres, presque le poids d’un homme, la sueur perle sur le front des deux travailleurs et la cruche d’eau se vide souvent. Enfin ! C’est fait.
Un petit cri strident perce les tympans des jeunes gens.
– Oh ! Les hommes…Le repas est prêt !
C’est la petite femme du meunier qui bat le rappel des hommes au labeur. Pour la première fois ils peuvent la détailler à la lumière du jour. Très petite avec un corps menu d’adolescente, elle pèse sans doute moins qu’un sac de farine. Son visage est toutefois marqué par le temps, une peau très fine et fripée lui donne l’air de porter un masque, aucun muscle ne bouge, seul ses yeux sont en mouvement. Après leur avoir désigné une place à leur table, leur hôte sort son couteau et tranche un gros pain qu’il partage.
– Maintenant on mange.
Le repas se passe en silence, deux bruits dominent : celui de la femme qui va et vient avec ses plats et celui de l’homme qui mange bruyamment, le nez dans son assiette, ignorant ceux qui l’entourent. Le repas est copieux : soupe avec des légumes et de la viande, tartine de saindoux, fromage, vin. Un rot clôture le festin, puis, le bruit sec du couteau qui se referme met un terme au déjeuner. Le bruit d’une charrette parvient aux oreilles de l’assemblée, sans doute le Bourru qui arrive. La femme regarde par la fenêtre et confirme.
– Je me demande qui est l’âne dans cet attelage, le mulet ou le Bourru ? Lance-t-elle sans sourire.
Le nouveau personnage est assez vieux. Il a des cheveux longs et gris qui lui tombent sur les épaules, un foulard noué autour du cou, une large veste qui semble remonter au temps des rois Louis et un pantalon rapiécé d’une couleur indéterminée qui s’arrête aux genoux. Des bas troués se terminent dans une paire de sabots fendus et usés par le temps. Ce personnage pittoresque va être le prochain compagnon de voyage des deux réfugiés. L’homme ne cherche pas le dialogue et passe tout de suite à l’essentiel.
– Y sont prêts mes sacs ?
– Mais oui l’ancêtre, ces deux lascars vont les charger pendant que tu me paies mon dû.
Les grognements du Bourru sont inaudibles mais une chose est certaine : l’individu porte bien son nom. Le bruit de ses sabots qui glissent sur le sol est aussi mélodieux que sa voix, il s’éloigne vers la demeure du meunier en émettant des bruits curieux.
Des voix s’élèvent de la cuisine, la petite voix de la femme ponctue les rires du meunier et les grognements du Bourru. Avec un orgue de Barbarie on aurait pu croire à une chanson de rue à trois voix que chantent parfois les artistes de passage.
– Hé les jeunes ! Prenez vos balluchons, votre carrosse vous attend.
– Faut pas me casser les pieds en cours de route…sinon…
Un clin d’œil de la Farine rassure les jeunes gens. Pendant qu’ils montent dans la charrette, le meunier les encourage une dernière fois.
– Il grogne mais ne mord pas. Ce soir vous serez à Saint-Mihiel, c’est la bonne route pour vous.
La mule part d’un petit trot nerveux secouant son chargement et ses passagers à chaque pas. Franz et Auguste ont le sourire car l’homme fait plutôt penser à un phénomène de foire qu’à autre chose. Sans raison apparente, il râle après quelque chose : la route trop chaotique, la mule trop nerveuse, la poussière, les jeunes …Mais jamais il n’adresse directement la parole aux jeunes gens qui l’accompagnent. Après une bonne heure de route, le vieil homme décide de faire une pause en précisant bien que ce n’est pas pour les passagers, mais pour la mule.
Franz, assis sur un muret à la limite d’un champ, aperçoit au loin une masse noire qui s’approche d’eux. Il en avertit ses compagnons. Le vieil homme, dont la vue est déficiente, met sa main en visière sur son front et pince ses yeux pour tenter de voir quelque chose. Franz et son ami voient maintenant distinctement l’homme qui arrive vers eux. Le Bourru est toujours dans sa posture de recherche…
– Ah ! Dit-il au bout d’un moment. C’est le colporteur.
L’homme tire une charrette à deux roues, les mains sur le brancard, une large courroie en travers de la poitrine est reliée à la charrette, il sert de monture à son magasin ambulant. Malgré l’effort, l’homme sourit aux voyageurs.
– Bonjour braves gens ! Si vous permettez, je me repose un instant parmi vous.
Sur ce, il range sa charrette qu’il cale avec une béquille. Toujours souriant, il s’assoit sur le muret au côté de Franz. L’un après l’autre, il dévisage les trois hommes sans rien dire.
– Vous vendez quoi ? Demande subitement Auguste.
– Mon bazar ambulant possède des trésors insoupçonnés : des rubans de toutes les couleurs pour les dames, de la lecture, du tabac, des ustensiles de cuisine, des jouets pour les enfants…
– Et des allumettes ?
– Bien sûr que j’ai des allumettes, et de première qualité.
Tout en parlant, le colporteur se dirige vers son bazar et déplie les côtés, laissant apparaître un meuble avec de multiples tiroirs. Sur les panneaux dépliés sont fixés des livres, des imprimés, des images pieuses en couleurs. De l’un des tiroirs, il extrait une petite boîte rectangulaire, assez épaisse, qu’il tend à Auguste. Franz intervient alors dans la conversation.
– Nous avons besoin d’un plat à réchauffer, d’un couteau, d’une fourchette et d’une cuillère…chacun.
Le colporteur flaire la bonne affaire et semble heureux de l’aubaine que le hasard des routes lui propose. Le Bourru reste à l’écart en haussant les épaules et en grognant de vagues remarques. L’heureux vendeur étale les marchandises demandées sur le muret pour que les deux voyageurs puissent apprécier la qualité de ses produits.
– Ca va nous coûter combien ? Demande Franz.
Le colporteur marmonne des mots inaudibles en se grattant la tête, il calcule…
– Deux francs et cinq sous chacun…je vous fais cadeau des allumettes.
Les deux jeunes Lorrains hésitent, Franz estime que la moitié de sa fortune va passer dans la poche du colporteur mais, nécessité fait loi, suivant d’ailleurs le conseil de Jean…
– C’est cher, mais je suis preneur. Dit Auguste désolé mais décidé.
– Moi aussi. Répond Franz en cherchant la monnaie pour le payer.
Heureux de leurs acquisitions, ils calent leurs biens dans le sac à dos sous le regard étonné du vieil homme qui hausse une fois de plus les épaules en marmonnant. Le regard du colporteur et du Bourru se croise un instant sans qu’aucun des deux ne disent un mot. Le vendeur ambulant replie ses panneaux tandis que le vieil homme grogne, invitant vertement les jeunes gens au départ.
– Bonne route ! Crie le colporteur, toujours avec le sourire.
Le jour tombe. Cela fait bien quatre heures qu’ils ont quitté le domaine du meunier. Les deux pauses de l’après-midi ont permis au mulet de reprendre des forces mais la brave bête n’est pas très rapide. Ce qui inquiète le plus Franz c’est qu’ils ne savent pas où dormir ce soir et le vieil homme refuse obstinément de converser.
– Dans une petite heure nous serons arrivés. Vous déchargerez la farine chez le boulanger du village et moi je rentre chez-moi avec ma mule.
Les voilà fixés sur l’avenir proche. Le Bourru les abandonne à leur sort sans autre forme de procès. Bientôt ils devinent un village au loin, le jour est tombé, la nuit s’installe doucement autour d’eux. Le boulanger a éclairé la devanture de son échoppe. La charrette s’arrête, le vieil homme descend et va à la rencontre du maître des lieux qui arrive à ce moment-là.
– Tu me dois trois francs pour le transport.
Sans un mot de plus, il s’installe sur son attelage et attend que les sacs de farine soient déchargés. Puis, il s’en va laissant ses deux compagnons de route avec leur étonnement, sans qu’ils puissent le remercier de les avoir guidés jusque-là.
– Bonsoir monsieur !
– Bonsoir ! Ne restez pas devant la porte, rentrez !
L’homme semble accueillant et sympathique. La boulangerie est très propre, les panières à pain vides sont parfaitement alignées sur des rayonnages, quelques traces de farine sur le bois du comptoir et sur le tranche-pain. Une bonne chaleur règne dans la pièce.
– Vous avez de la chance ; d’habitude le Bourru ne s’occupe de personne. Il n’est pas méchant mais vit dans un autre monde que le nôtre. A propos ! Que faites-vous ici ?
– Nous sommes des réfugiés lorrains et pour l’instant nous recherchons un abri pour dormir cette nuit.
– Pour ça, pas de problème. A la sortie du village, il y a une ferme abandonnée, le toit est encore bon, vous serez à l’abri. Je n’ai pas grand chose à vous offrir, mais vous mangerez bien une soupe chaude. Venez !
Le brave boulanger fait rentrer les deux amis dans l’arrière boutique qui semble être aménagée pour manger et dormir. Sans doute que le boulanger s’y repose et s’y restaure en attendant que son pain soit cuit. Au fond de la pièce, une petite porte donne sur le fournil, une odeur sympathique de pain frais flotte dans l’air et les deux invités ne se sentent pas de refuser un bon plat.
– Mon nom est Charles ! Asseyez-vous sur le banc, je vais chercher la soupe qui chauffe près du four à pain.
Franz et Auguste vont avoir l’occasion d’étrenner leurs récentes acquisitions. Chacun sort son écuelle, sa cuillère, sa fourchette et son couteau, flambants neufs. La soupe arrive, puis du pain et une bouteille de vin, cet homme sait recevoir. La question du gîte étant réglée également, Franz a malgré tout un souci ; il se demande comment rejoindre Mailly ?
– La guerre a détruit la voie ferrée toute neuve, mais à partir de Bar-le-Duc, les ouvriers du chemin de fer ont réparé jusqu’à Vitry-le-François. Après il faudra marcher pendant une bonne journée pour arriver à Mailly.
– D’ici Bar-le-Duc, va falloir marcher alors ! S’exclame Auguste. C’est loin !
– Une petite journée…Vous trouverez bien un roulier. Ils ont repris du service depuis la fin de la guerre.
Le repas terminé, les deux jeunes gens remercient le brave homme pour son hospitalité. Ils partent dans la nuit vers cette ferme abandonnée, Dieu sait pourquoi. Une porte, posée simplement contre le chambranle où il manque les supports, rend l’accès libre à la demeure. Une grande pièce vide avec une cheminée, sans aucun meuble, seul un balai confectionné avec des branchages, trône dans un coin. Ils se mettent en quête de bois pour faire un feu et Auguste est tout heureux de justifier l’acquisition de ses allumettes. Une nouvelle journée de rencontres et d’expériences sur la nature humaine les a enrichis un peu plus, ils ne savent pas de quoi sera fait le lendemain, mais ils sont confiants. Las, ils vont dormir du sommeil du juste.
C’est la fraîcheur du matin qui les réveille, le jour se lève à peine. Pour la première fois depuis qu’ils ont quitté leur pays natal, ils sont livrés à eux–mêmes ; il faut maintenant décider de la conduite à tenir, trouver de la nourriture, du travail, un transport… Bref ! Ils ne pourront plus compter sur un Jean ou un brave boulanger. C’est à eux de tracer le chemin de leur avenir et d’essayer de ne pas tomber dans le fossé de la misère et des travers des malhonnêtes gens.
Pendant quatre jours ils errent sur les routes, à pied ou profitant de la gentillesse d’un roulier. Ils vont proposer leurs bras dans des fermes pour s’assurer un repas et dormir dans un abri, ils vont connaître le coût de la liberté pour survivre dans un pays ravagé par la guerre et qui revient doucement à la vie au milieu des destructions et des misères. Ils ne se doutent pas que la vie, dans laquelle ils sont entrés désormais, leur réservera d’autres surprises, pas toujours très agréables. Mais ils avancent.
Au cours de l’après-midi du quatrième jour, ils aperçoivent enfin le village de Mailly. Ils comprennent immédiatement pourquoi le nom de ce village s’est transformé en Mailly-le-Camp ; des militaires passent au galop, des attelages d’artillerie se pressent hors des routes, en plein champ, pour franchir de petites collines, laissant des sillons profonds derrière eux. Des campements de toiles, bien alignés, se dressent par-ci, par-là. Le son d’une trompette de cavalerie se fait entendre, des hommes courent au milieu des campements, se rassemblent ; c’est une activité permanente et bruyante qui contraste avec le calme qu’ils viennent de connaître dans les campagnes qu’ils ont traversées depuis quatre jours. A un carrefour de route, un militaire en arme semble perdu dans l’immensité du décor, il est seul, appuyé sur son fusil, des fanions verts et rouges sont plantés dans le sol à côté de lui, il fume une pipe et observe attentivement leur approche.
– Oh-là ! Où allez-vous tous deux ?
– Au village, répond Franz, nous sommes des Lorrains réfugiés et …
– Ah oui ! Encore…Je suppose que vous cherchez le campement ?
– Ben oui !
– Traversez le village, faites une demi-heure de marche et vous ne pouvez pas le manquer, c’est un grand camp de toile…Ne quittez pas la route, il va y avoir des tirs réels. Salut !
Ils reprennent leur chemin vers ce village qui doit être la fin d’un voyage et sans doute le début d’une nouvelle vie. Le renseignement du soldat s’avère exact ; une demi-heure de marche plus tard, les voici devant le camp de toile. L’entrée est marquée par un portique sur lequel un panneau souhaite la bienvenue aux français d’Alsace et de Lorraine. Pas de doute, c’est ici.
Deux militaires sont en faction devant l’entrée ; un civil en redingote noire se tient près d’une tente de couleur écrue dont le mât central monte assez haut, ce qui donne un aspect de chapeau pointu à l’ensemble. L’homme est en train de converser avec un autre civil, il nous aperçoit et fait signe d’approcher.
– Bonjour jeunes gens ! Etes-vous des réfugiés ?
– Bonjour monsieur ! Nous venons de Lorraine, enchaîne Franz.
– Entrez ! Posez vos sacs à l’entrée, nous allons nous asseoir sous la tente pour bavarder.
Tous deux s’installent. Arrive un soldat en arme, puis l’homme en redingote qui se met derrière un petit bureau, il étale des feuilles de papier devant lui et se met à écrire quelques instants avant de parler.
– Vous allez tout d’abord me donner votre nom, celui de vos parents, le lieu d’où vous venez. Ensuite nous parlerons un peu.
Franz et Auguste déclinent leur identité et celle de leurs parents. Chacun indique la ville d’où il vient et la profession qu’il exerçait avant de quitter la Lorraine. Aucun des deux n’a eu à faire à la police, mais ils ressentent bien le ton inquisitoire de l’homme à la redingote, ses questions rapides ne laissent pas le temps de la réflexion et s’enchaînent comme les éclairs d’un orage d’été. Troublés, les deux réfugiés se sentent presque coupables d’une défaite militaire et de ses conséquences, ils se posent la question de savoir si leur démarche a été la bonne. Et puis ce militaire en arme à l’intérieur qui les observe sans dire un mot, faisant obstacle de son corps pour empêcher quiconque de sortir de la tente. Pourquoi cette méfiance ? L’entretient dure depuis une heure environ, l’homme se lève et les regarde intensément.
– Bien ! Nous allons vous installer pour la nuit et au besoin, nous nous retrouverons demain. Garde ! Escortez ces jeunes gens chez le fourrier du camp pour qu’il les équipe et les affecte à une section.
Franz et Auguste avalent leur salive avec difficulté ; ils sont très inquiets et ont la nette impression d’être des coupables. Coupables de quelque chose qu’ils ignorent encore et qu’ils vont découvrir dans très peu de temps. Ils suivent ce soldat à travers le camp sans dire un mot, sans se regarder, l’esprit embrouillé par les questions de cet homme en noir. Quelques baraquements, de construction sommaire, fait dans l’urgence semble-t-il, apparaissent entre deux allées de tentes ; c’est dans l’un d’eux qu’ils pénètrent avec le garde. Il fait sombre, une odeur de rance y règne. Un militaire en surchemise, les deux mains sur un comptoir qui fait toute la longueur du baraquement, semble les attendre.
– Encore deux nouveaux ! Ils parlent français au-moins ?
Franz et Auguste se regardent, étonnés, perplexes. Que veut-il dire ?
– Ces réfugiés qui fuient les Prussiens et qui veulent rester français…Ils ne parlent même pas notre langue ; c’est à ni rien comprendre. Vous êtes Lorrains ou Alsaciens ? Parce que les Alsaciens…Il me faut un interprète.
– Nous sommes lorrains monsieur et…
– Bien ! C’est déjà ça. Parce que les Alsaciens…Vos noms…
Il inscrit les noms et prénoms sur un registre. C’est évident, le fourrier a une dent contre les Alsaciens, Franz et Auguste reprennent courage, ils l’ont échappé belle. Le soldat qui les accompagne ricane mais ne parle toujours pas.
– Voyons ! Un sac à viande chacun, une couverture, une gourde, une gamelle avec couverts…Voilà de quoi dormir et manger ; vous êtes affectés à la troisième section, le garde va vous conduire.
Chargés comme des mules avec leur sac et leur couchage, ils suivent péniblement le garde, faisant des prouesses pour ne rien laisser tomber. Ils arrivent enfin. Le garde les confie à un militaire moustachu qui les reçoit sèchement.
– Attention les canailles…Ici, pas de bagarres, pas de disputes, pas de vols. Il est interdit de quitter le camp, les rassemblements du matin, midi et soir sont obligatoires ainsi que les repas. Vous êtes six par guitoune et vous serez dans la dernière de cette rangée. Vous êtes à la troisième section et je suis le sergent Lasbordes. Rompez !
En quelques secondes, les deux réfugiés ont pris connaissance du règlement du camp, de quoi dormir, de quoi manger. Le grand regret d’Auguste c’est d’avoir dépensé son argent pour s’équiper avec gamelle et couverts. L’armée, généreuse, offre le gîte…et les couverts. Pour la première fois depuis leur arrivée, ils rient aux éclats de leur aventure.
L’entrée de la tente est assez basse, La grande taille de Franz lui impose de se plier pour pénétrer dans son nouveau logis. L’intérieur est éclairé par la lumière du jour qui filtre par une ouverture qui ressemble à une fenêtre, six lits sont posés, trois de chaque côté, laissant un passage vers l’entrée. Sur un des lits, un jeune homme, maigre, les cheveux en bataille, observe les nouveaux locataires.
– Salut !
– Salut ! Répondent les deux nouveaux. Je m’appelle Franz et voici Auguste…Nous sommes Lorrains. Je suppose que tu es un réfugié comme nous ?
– Oui ! Oui ! Je suis d’un petit village, près de Saint-Avold. Mes parents sont morts et je ne savais pas où aller. Ce sont des soldats français, prisonniers, qui m’ont recueilli, quand ils ont été libérés, ils ont tous été dirigés sur Mailly, puis, je me suis retrouvé là. Maintenant c’est les réfugiés civils qui arrivent.
– C’est quoi ton nom ?
– Nicolas Echenbrenner, j’ai seize ans depuis la semaine dernière.
– Puisque tu es seul sous cette tente, nous choisirons les lits du fond, il me semble que près de l’entrée il y a trop de courant d’air. Tu vas nous raconter la vie du camp pendant notre installation.
Pendant un long moment, le petit Nicolas relate le rythme de la vie du camp : réveil six heures, rassemblement et comptage des effectifs, distribution de pain et de lait chaud, répartition des corvées, rassemblement et repas de midi. L’après-midi repos jusqu’à six heures, heure du repas. Corvée de gamelle pour certains puis, extinction des feux à neuf heures.
Auguste fait remarquer qu’à leur arrivée, ils n’ont vu personne hors des tentes alors qu’il semblait y avoir du monde.
– C’est le sergent ; il ne veut pas de traînards dans le camp. Il dit que si chacun reste dans son carré, personne ne se fera voler quoi que ce soit. Il ne veut pas entendre parler le patois lorrain ou l’alsacien, il dit que nous sommes des espions.
L’esprit de Franz est troublé par ce qu’il vient d’entendre, lui qui ne voulait pas devenir Allemand, qui a abandonné sa famille, ses amis, son métier, pour rester Français. Le voilà bien déçu par ceux qui ont écrit « Bienvenue aux Alsaciens et aux Lorrains » sur le portique à l’entrée du camp. Le jeune Nicolas poursuit :
– Quand il y a beaucoup de monde dans le camp, ils rassemblent trois à quatre cents personnes et ce sont des gendarmes à cheval qui les encadrent pour prendre la route. Certains sont dirigés vers Paris et d’autres vont vers le sud, à Marseille je crois. L’armée recrute beaucoup, surtout pour l’Afrique. Il y a toujours la guerre là-bas. Comme dit le sergent : « Faut bien les caser quelque part, ils veulent être Français ! Alors qu’ils le prouvent.» J’ai assisté à plusieurs départs, le sergent ne me met pas sur les listes, il dit que je dois d’abord faire mes classes.
Un roulement de tambour met fin au monologue du petit Nicolas.
– C’est le repas du soir. Prenez vos gamelles et suivez-moi.
Comme une fourmilière qu’un coup de pied a affolée, des hommes de tous âges sortent des tentes et se dirigent vers le lieu de rassemblement. Le sergent fait accélérer le mouvement en hurlant des menaces allant de la privation de nourriture à l’excommunication. Auguste fait remarquer qu’il n’y a pas de femmes ni d’enfants et Nicolas donne la réponse en chuchotant que les familles sont dans un autre camp. Seuls les célibataires sont à Mailly. Les colonnes se forment pour se diriger vers une cuisine roulante où deux hommes en tablier de cuir, comme ceux des forgerons, servent de la soupe et des pommes de terre. Une table avec du pain à volonté est dressée à côté. Une fois servie, chacun s’en retourne vers sa tente. Le repas est chaud mais rapidement pris ; Auguste fait remarquer qu’il ne donne rien à boire et qu’il n’avait pas vu de fontaine depuis son arrivée.
– C’est le sergent ; il ne veut pas de viande saoule comme il dit. Répond Nicolas, mais je crois que les soldats gardent le vin pour eux. Il y a un baraquement avec des pompes à bras où chacun peut se laver et remplir sa gourde. Si vous voulez, je vous y emmène.
La proposition du petit Nicolas est la bienvenue après une journée de marche sur les routes poussiéreuses et les dernières émotions. Le repas terminé, ils se dirigent donc tous les trois vers le baraquement en question pour se laver. Nicolas active vigoureusement le bras d’une pompe et l’eau jaillit d’un tuyau percé en plusieurs endroits. Les deux arrivants ne connaissant pas le système, se font copieusement arroser de la tête aux pieds sous les rires de Nicolas, heureux de cette bonne farce. Franz et Nicolas se déshabillent et, nus comme des vers, ils laissent couler cette eau fraîche et bienfaitrice sur leur corps.
– Eh ! Les amis, ça suffit maintenant, je fatigue à pomper…
Se séchant avec leur chemise, ils remettent leurs vêtements et s’en vont d’un pas rapide vers leur tente. L’installation pour la nuit commence. Les lits sont faits de deux croisillons en bois reliés entre eux par trois bras. Une toile épaisse et prise dans les deux bras du dessus, bien tendue, ce qui donne une couche confortable. Franz et Auguste travaillent à l’imitation en observant le petit Nicolas préparer son couchage. Il met ses vêtements sur la toile même du lit, étale son sac à viande, espèce de drap cousu, ne laissant qu’une ouverture pour enfiler le corps entier comme le pied enfile une chaussette, puis, étale une grosse couverture par-dessus. Son petit sac, sur lequel il a posé sa chemise, lui sert d’oreiller. Nicolas a remarqué que les deux nouveaux l’observaient.
– C’est le sergent qui m’a montré. Comme ça les vêtements sont chauds au petit matin et de plus ça isole du froid. Les chaussures, il faut les mettre à l’envers sur un bout de bois pour que les bestioles ne rentrent pas dedans. C’est le sergent qui le dit.
Auguste se fait un devoir de montrer à Nicolas comment un de leurs amis, un sergent-major, lui, s’éclairait le soir. Il sort une bougie de son sac et une boîte d’allumettes, l’allume et l’installe sur le rebord de son lit. Le jour tombe ; une bonne nuit les attend.
Roulement de tambour.
– Debout ! C’est le rassemblement.
Nicolas est déjà debout, il enfile ses vêtements et encourage ses deux nouveaux amis. Il faut faire vite car le sergent n’aime pas attendre. Franz et Auguste n’ont pas la technique pour s’extraire du sac à viande, des jurons fusent sous la tente. Franz tombe du lit, les jambes emprisonnées dans le sac. Auguste qui a voulu s’asseoir vers la tête du lit pour sortir de ce drap cousu de toutes parts, fait basculer l’ensemble et se retrouve à terre le lit sur la tête. Le spectacle amuse beaucoup le petit Nicolas qui est plié de rire. Les voilà enfin prêts. Dehors, des hommes qu’ils avaient à peine entrevus la veille, se pressent vers le lieu de rassemblement. Nicolas sert de guide et place les deux nouveaux dans le carré qui s’est formé. A l’appel de leur nom, chacun répond « Présent ! » d’une voix forte. Ce qui n’empêche pas un soldat de compter le groupe au cas où un plaisantin…La confiance règne.
– Sont convoqués à la direction du camp…
Franz Rheinhardt…Auguste Muller… Ceux qui ont été convoqués suivent le garde jusqu’au bureau du camp.
– Ce n’est rien, mes amis, ils questionnent les nouveaux pendant plusieurs jours. Dit le jeune Nicolas l’air rassurant.
Une dizaine de réfugiés forment le groupe et suivent le garde, colonne par un, sans un mot. Arrivé devant la baraque de la direction du camp, l’homme en redingote noire apparaît et se plante devant eux, les mains croisées derrière le dos, les jambes légèrement écartées.
– Je vous salue ! A l’appel de votre nom, vous vous présenterez à l’intérieur du bureau où je vous recevrez un par un. Nous allons faire plus ample connaissance.
Les deux Lorrains se regardent, l’œil interrogateur. Que veut bien vouloir cet individu à l’allure inquiétante ? L’un après l’autre, les réfugiés défilent devant ce sinistre personnage. Arrive le tour de Franz. L’homme en noir est assis derrière un bureau, des dossiers s’empilent de chaque côté laissant apparaître le buste et la tête de l’inquisiteur. Une des piles de dossiers empêche la lumière du jour d’éclairer son visage que l’on devine à peine, Franz est debout et attend. L’homme se met à parler.
– Pourquoi voulez-vous rester Français ?
Franz ne sait pas quoi répondre à cette question si froidement posée. Il hésite, puis explique sa peur des Uhlans, la guerre…
– Nous aussi nous faisons la guerre. Pour faire la guerre il faut être au-moins deux. Ce n’est pas une bonne raison que vous me donnez-là. Vous avez un métier…faïencier je crois, vous avez vos parents, votre maison…Alors qu’elle est vraiment la raison ?
– Depuis toujours, j’entends parler des guerres qui se sont déroulées dans notre région, des destructions, des morts. Dans nos familles, nous en parlons souvent aux veillées et les anciens nous racontent des choses affreuses. Je veux rester Français parce que, quitte à partir de chez-moi, j’ai préféré venir à l’intérieur que de l’autre côté.
– Pardon ! Je ne comprends pas cette dernière phrase : cela veut dire quoi exactement ; l’intérieur…l’autre côté ?
– Pour nous, vous êtes des Français de l’intérieur, l’autre côté c’est l’Allemagne.
– Bien ! J’ai plusieurs propositions à vous faire jeune homme. Dans deux jours, un nouveau convoi va partir vers Marseille. Vous aurez plusieurs possibilités ; soit vous restez dans la région marseillaise, soit vous souscrivez un engagement dans l’armée, soit vous partez en Afrique du Nord pour devenir colon. Que pensez-vous de mes propositions ?
– …
– Réfléchissez jusqu’à demain matin. La nuit porte conseil dit-on. A demain…
– Au-revoir monsieur !
Franz retrouve le groupe, il est perturbé par les propositions de l’homme en noir, son visage doit exprimer une terreur qu’il communique à ce pauvre Auguste. Incapable de dire un mot pendant plusieurs minutes, il se reprend enfin pour expliquer à son ami ce qu’il vient de vivre. Puis c’est au tour d’Auguste de subir l’épreuve des questions de l’inquisiteur.
Un bon quart d’heure après, Auguste sort du baraquement, les yeux sont encore plus grands que d’habitude, effrayé, presque paniqué. Ses mains tremblent, son front est moite. Un de leurs compagnons lui propose sa gourde et le pauvre Auguste boit goulûment cette eau fraîche qui lui dégouline sur le menton.
Le garde les libère, ils retournent songeurs vers la tente où les attend le petit Nicolas. Aucun d’eux ne parle. Lorsqu’ils pénètrent sous la tente, un homme est assis à côté de leur jeune compagnon. Il doit avoir une trentaine d’années, très bien vêtu, il a l’air d’un fils de bourgeois avec ses mains soignées et ses cheveux parfaitement peignés.
– Bonjour mes amis ! Dit-il en se levant et en tendant la main. Mon nom est Alexandre Baumgartner, réfugié comme vous, je viens de Strasbourg. Nous sommes tous dans la même galère…Si je peux vous être utile…
Les salutations de cet homme ont été exprimées dans un français parfait, presque sans accent ce qui fait penser qu’il a reçu une bonne éducation et une aussi bonne instruction. Le fourrier du camp n’a pas du avoir recours à un interprète pour dialoguer avec cet Alsacien. Les deux Lorrains s’installent sur leur lit, regardent les deux autres qui attendent que l’un d’eux raconte leur dernière aventure. C’est Franz qui va rompre le silence.
– C’est incroyable…Jamais je n’aurai pu imaginer…C’est un mauvais rêve.
Presque en colère, il relate en détails l’entrevue avec l’homme en noir. Offusqué de sa méfiance et de son attitude envers les réfugiés. Auguste laisse échapper un mot de temps en temps, pour confirmer les propos de son ami.
– Ce n’est quand même pas de notre faute si la France a perdu la guerre, l’Alsace et la Lorraine. Mon grand-père avait raison, notre pays est enclavé entre deux prétendants qui se disputeront toujours cette terre. Maintenant ils veulent que je me batte pour eux en Afrique…Drôle d’accueil.
Alexandre, qui a écouté le récit de son jeune compagnon, prend la parole.
– Je pense qu’il faut comprendre les autorités ; simultanément, la France subit la perte d’une guerre et des territoires, une révolution parisienne avec les communards, des conflits dans nos colonies, cela fait beaucoup pour un pays. Une autre révolution est en marche, industrielle celle-là, il faut des bras dans les usines, bras qui viennent de la campagne qui se dépeuple. Des métiers disparaissent, d’autres surgissent, la misère s’installe chez ceux qui ont du mal à s’adapter. L’armée, mise à mal, recrute, la gendarmerie également augmente ses effectifs. Bref ! La France est en pleine transformation. Personnellement, j’ai pris ma décision ; je pars en Algérie où l’Etat offre des terres à ceux qui veulent les exploiter. Déjà en 1848, des milliers de Parisiens avaient assisté au départ de 13 500 émigrants sur des chalands qui ont rejoint Marseille par voie d’eau. C’était l’époque de Bugeaud : « ense et aratro, par l’épée et par la charrue.» Certes, tous n’ont pas réussi en Algérie, mais c’est une chance qu’il faut saisir et pour nous qui n’avons plus le sou, c’est même inespéré.
La démonstration magistrale que vient de faire l’érudit Alexandre, laisse son auditoire sans voix pendant un petit moment. Le cerveau en ébullition et l’estomac dans les talons, car ils n’ont rien mangé depuis le réveil, chacun réfléchit à son avenir. Armée, colon, Algérie, guerre, tout ceci trouble l’esprit de ces jeunes gens complètement désemparés. Ils trouveront bien une solution, il reste vingt-quatre heures pour donner une réponse à l’homme en noir. Alexandre a fait son choix, mais il possède des éléments que les deux Lorrains ignorent. Franz décide de partir à la quête d’informations en sollicitant leur nouvel ami.
– Comment as-tu fait pour avoir toutes ces informations ? Parle-moi de l’Algérie…C’est quoi cette histoire de terre ?
– Si vous voulez, nous allons faire un peu d’Histoire, avec un grand H, pour comprendre la situation de la France, et de l’Algérie actuellement. Lorsque je faisais mes études à Paris, notre professeur d’histoire, un maître en la matière, nous a non seulement enseigné le passé de notre pays, mais aussi, enseigné à analyser les situations pour nous permettre de deviner le futur proche et les conséquences de nos actes politiques, avec une marge d’erreurs relativement faible. Au moment où nous parlons, l’Empereur est prisonnier, l’Empire est devenu une République, la troisième du nom. La guerre civile de la Commune de Paris a eu une nette tendance révolutionnaire socialiste. Versaillais et fédérés s’affrontent dans un climat de haine qui caractérise les guerres civiles, de part et d’autre les troupes régulières et les insurgés se livrent un combat sans merci et la répression fut atroce. Monsieur Thiers a fait exécuter plus de vingt mille personnes « pour guérir Paris de la gangrène morale qui la ronge… » comme écrit le journal le Figaro, le serpent à lunette, c’est ainsi que l’on surnomme monsieur Thiers, paiera sans doute ses excès sanguinaires un jour prochain. La question est de comprendre pourquoi les Parisiens se sont insurgés. Durement éprouvés par un siège dont ils ont souffert physiquement, une occupation passagère mais humiliante de la capitale, la classe ouvrière montrait un violent mécontentement, une colère annonciatrice d’une formidable explosion. En 1830, puis en 1848, la bourgeoisie avait volé leur révolution et le peuple de Paris ne voulait pas que l’histoire se répète. Sous le Second Empire, la France s’est enrichie. La classe ouvrière a vu son salaire augmenter d’un tiers mais les denrées de moitié. Les taudis se multiplient alors que l’on perce des grands boulevards dans Paris, la misère ne cesse de s’étendre. La vexation d’une guerre perdue, la faim, le chômage, ont été les ingrédients de cette nouvelle révolution. Le pouvoir est vacant. Monarchistes, bonapartistes, légitimistes, républicains, tous visent la victoire politique.
– Auguste et moi avons connu un ancien soldat qui nous a raconté des choses horribles qui se sont déroulées à Paris. Une guerre civile c’est terrible…
– Il n’y a pas pire.
– Mais alors cette guerre dans nos colonies, en Algérie, c’est pour quoi… Contre qui…?
– L’Algérie n’est pas vraiment une colonie, c’est le prolongement de la France sur l’autre rive de la Méditerranée. La Constitution de 1848 a proclamé l’Algérie partie intégrante du territoire français. Sa superficie est de quatre fois la France, elle n’est peuplée que de deux millions d’habitants, depuis sa conquête, en 1830, l’Algérie a toujours été le champ de manœuvres et le domaine réservé de l’armée. La conquête et la colonisation ont progressé conjointement. Les colons établis depuis des années maintenant, sont d’une tendance républicaine et n’ont pas tellement apprécié la politique de Napoléon III. Tous issus de l’immigration, ils s’accrochent à leur terre, à leur concession. Capitalistes métropolitains, fonctionnaires et officiers font le trafic des terres abandonnées au titre de la conquête. C’est l’époque des « colons en gants jaunes », aristocrates décatis épris d’orientalisme. C’est l’injustice envers les Arabes qui provoque les révoltes ; même si les terres « récupérées » sont en friches, c’est une acquisition due à une expropriation donc fatalement injuste aux yeux des autochtones. Nous sommes bien placés pour comprendre leur réaction, et pourtant…Conscient de ces problèmes, je tente malgré tout l’aventure ; dans quelques années nous aurons peut être apporté quelque chose à cette région du monde. De toute façon, il m’est impossible de retourner chez-moi à Strasbourg, sauf si la fortune des armes nous est favorable la prochaine fois. Car je suis convaincu que nous serons vainqueurs la prochaine fois et que l’Alsace sera française, définitivement j’espère.
– Tu crois qu’il y aura une autre guerre chez-nous ? Dit Auguste avec une petite voix cassée par la crainte.
– Je pense que oui ! Sans doute dans quinze ou vingt ans…En attendant, il faudra survivre et se créer les conditions d’une nouvelle vie. C’est pour cette raison que j’ai fait le choix de l’Algérie.
Roulement de tambour. C’est déjà l’heure du repas.
– Allons-y ! Une fois de plus nous aurons au menu une soupe et des pommes de terre. Je vais récupérer mes couverts et je vous retrouve ici.
Comme la veille au soir, même rituel, même menu. Il vaut mieux manger sur place, la soupe refroidit vite. Le temps d’écraser les trois pommes de terre dans le bouillon, l’affaire se fait. De toute manière, il faut laver les gamelles et prendre de l’eau. Le retour vers la tente se fait donc assez rapidement. Sur le chemin du retour, ils aperçoivent Alexandre en conversation avec un groupe d’individus. Auguste, soucieux, est inquiet pour sa famille qu’il n’aurait jamais du quitter, il se confie à son ami Franz :
– Après avoir écouté Alexandre, je crois qu’une autre guerre va arriver et je ne dois pas être loin de mes parents. En attendant que le calme revienne, je vais rester en France et je vais prendre du service dans la gendarmerie. Ils ont des chevaux…
– Tu as encore jusqu’à demain matin pour réfléchir…Les terres en Algérie, c’est bien beau tout ça, mais je ne suis pas paysan, je n’y connais pas grand chose à la terre. La faïencerie c’est tout ce que je sais faire, mon père a bien un petit jardin pour nos légumes mais mon expérience s’arrête-là.
– Pour moi le problème ne se pose pas, Répond le petit Nicolas, le sergent ne veut pas que je parte…Alors !
Une fois sous la tente, chacun range ses gamelles. Nicolas attend patiemment la suite des événements, Auguste se déchausse et s’allonge sur son lit de camp. Franz reste debout, à l’entrée de la tente. Silencieux, il observe les alentours en bras de chemise, les mains dans les poches. Alexandre l’intrigue, il n’a pas l’accent des gens de son pays, trop bien habillé pour quelqu’un qui erre sur les routes et dans un camp. Il y a quelque chose qui cloche.
– Nicolas ! J’ai une question à te poser. Alexandre, il y a longtemps qu’il est dans le campement ?
– Y a bien une quinzaine de jours que je le vois. Mais il ne m’a jamais parlé avant votre arrivée.
– Les derniers réfugiés sont partis quand, la dernière fois ?
– Y a bien dix jours maintenant ! Répond Nicolas.
Auguste s’est redressé sur son lit, il comprend où Franz veut en venir. Leurs regards se croisent et chacun devine la pensée de l’autre. C’est incroyable, Alexandre serait-il un espion de l’homme à la redingote noire ? Méfiants, ils attendent la suite. Franz reste à son poste de guet et attend le retour du Strasbourgeois de Paris.
– Le voilà qui arrive notre ami Alexandre !
Franz s’efface pour laisser le passage libre à celui dont il se méfie désormais. Jovial et décontracté, il se soucie de savoir si tous ont suffisamment mangé et que personne n’a de problèmes particuliers. Personne ne répond. Alexandre a subitement le sentiment qu’il n’est pas le bienvenu et s’empresse de poser la question :
– Que se passe-t-il ? Aurais-je fait une chose déplaisante ou blessante ? Parlez ! …J’aimerais savoir.
– Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ton histoire, dit Franz. Tu es habillé comme un prince, tu n’as pas l’accent alsacien et tu circules dans le camp depuis deux semaines. Il y a de quoi se poser des questions.
– Pardon mes amis ! J’aurais du commencer par vous expliquer la raison de ma présence ici. Je suis en liaison avec des associations d’aide aux réfugiés ; « La Société catholique des Alsaciens et Lorrains » et « L’Association Générale d’Alsace et de Lorraine.» Ces associations ont des représentants dans les différents camps ainsi qu’à Marseille où ils peuvent intervenir pour aider les plus démunis et les malades. En règle générale, nous proposons un départ sur l’Algérie à ceux qui sont solides, paysans de métier et en famille. Les célibataires, nous leurs conseillons de s’enrôler dans l’armée, qui actuellement est la solution la plus sage pour ne pas finir dans la misère. Certes, il y a des risques, mais pas plus que les épidémies qui sévissent régulièrement dans notre pays. Pour les volontaires au départ, nous essayons de les regrouper par région, puis de les orienter vers des villages de colons déjà occupés par des gens de l’Est. Cela a été fait à Tizi-Ouzou, au Camp-du-Maréchal et à Azib-Zamoun, c’est à l’Est d’Alger.
– Faut pas m’en vouloir, je suis devenu méfiant.
– Je te comprends mon cher Franz, moi aussi à mes débuts parisiens, j’ai été roulé plus d’une fois dans la farine.
– Quel gâchis ! S’exclame le petit Nicolas, ce qui fait rire les trois autres.
L’ambiance est à nouveau détendue. Alexandre propose de faire le point avec chacun, suivant ses aspirations et ses désirs propres. Il rappelle la situation économique désastreuse de la France, le chômage, la misère. C’est Auguste qui se lance le premier, il y a déjà réfléchi et sa décision est prise.
– Pour moi, c’est simple. Je ne suis pas tenté par l’Algérie ; quand j’ai quitté mon village je ne savais pas ce que c’était. Notre ami Jean, que nous avons rencontré en chemin, nous en a parlé longuement de sa guerre en Afrique…Toi aussi Alexandre, tu nous expliques que les colons sont de drôles de gens, que les fonctionnaires et les militaires profitent de cette situation et commettent des choses pas bien. Alors, je reste en France et je vais m’enrôler dans la gendarmerie. De toute façon, un jour ou l’autre, je serai appelé dans l’armée.
– C’est une bonne décision, reprend Alexandre. Mais sache quand même, la gendarmerie est en lutte permanente contre les criminels, les violeurs et les bandits de grands chemins. Pour eux, c’est un combat de tous les jours. Et toi Franz ? Qu’as-tu décidé ?
– Je suis tenté par cette affaire, changer de vie, de métier, voir d’autres pays…Je crois bien que je vais faire ce voyage. Par contre, je ne sais pas comment prévenir mes parents. Depuis mon départ, ils n’ont aucune nouvelle…Comment faire pour leur faire parvenir un mot de ma part ?
– Oh ! Mais c’est très simple, tu fais un courrier, je l’expédie par la poste du village et tes parents auront cette lettre dans quelques jours.
– Malgré la guerre et l’occupation ?
– Bien entendu ! La circulation des personnes n’est pas interdite, la preuve : vous êtes-là. Et puis la guerre est terminée. Les politiciens ont pris les choses en main pour les frontières, la circulation des marchandises et des personnes. Pendant quelques années, notre pays va encore souffrir de privations, de chômage et de misères ; une solution s’offre à nous et je crois qu’il faut la saisir.
– Pour moi le problème ne se pose pas, lance Nicolas…Mais il est interrompu, les trois autres lancent en chœur la suite de la phrase…
– Le sergent ne veut pas ! Et tous éclatent de rire.
Le reste de la journée se passe sous la tente. Alexandre est revenu, apportant de quoi écrire, Franz et Auguste s’appliquent à rédiger un pli à l’adresse de leurs parents. Chacun tente de les rassurer et de les informer de leur décision. Pour Auguste ce sera la gendarmerie, de plus, ils ont de très beaux chevaux, et il restera en France. Franz est partant pour l’Algérie, mais il ne dit pas dans sa lettre qu’il veut s’engager dans l’armée dès son arrivée à Marseille. Pour le reste, il verra plus tard en fonction des événements. Demain matin, après l’appel, ils reverront l’homme à la redingote noire et ils lui soumettront leurs décisions. La nuit est installée depuis un bon moment, Auguste a allumé une chandelle. Personne ne parle sous la tente. Franz et Auguste cherchent un sommeil qui ne vient pas, chacun est loin avec ses pensées, son imagination, ses questions sans réponses.
Roulement de tambour.
Le matin est enfin arrivé. Les trois compagnons se réveillent difficilement, il faut aller au rassemblement, trouver Alexandre pour lui remettre les lettres, confirmer leurs intentions à l’homme en noir. La journée s’annonce chargée.
– Sont convoqués à la direction du camp…Auguste Muller…Franz Rheinhardt…
Les dés sont jetés. A l’appel de leur nom, ils entrent dans le baraquement pour l’entretien avec l’homme en noir. C’est au tour d’Auguste.
A peine vingt minutes se sont écoulées ; Auguste ressort avec le sourire et rejoint son ami parmi le groupe en attente. Tous l’observent et attendent ses commentaires.
– C’est fait pour moi. Il m’a promis que je serai à Paris dans une semaine et que la gendarmerie m’enrôlera sans problème. Ils vont me préparer les papiers nécessaires et me donner l’adresse où je dois me présenter.
L’attitude souriante d’Auguste rassure le groupe.
– Franz Rheinhardt…
Franz avale une grosse boule de salive qui ne veut pas passer. Il toussote, se racle la gorge et enfin s’élance vers l’entrée du baraquement. L’homme est là, assis derrière une montagne de dossiers, son visage caché par l’ombre des piles de papiers. Impossible de deviner son expression.
– Alors mon jeune ami ! Qu’avez-vous décidé ? J’espère que la nuit vous a apporté de bons conseils. Je vous écoute.
– Je ne suis pas de la campagne, j’ai travaillé dans une fabrique et donc la vie de colon en Algérie n’est peut-être pas la solution pour moi. Mais je voudrais bien m’engager dans l’armée pour partir là-bas.
– Savez-vous qu’il y a toujours des révoltes dans ces pays ? Vous fuyez une guerre pour en faire une autre ; je ne vous comprends pas…
– Je ne fuis pas une guerre, monsieur, je fuis les Allemands…
– Bonne réponse ! Vous marquez un point. L’armée enrôle effectivement et particulièrement pour les colonies. La Chine, l’Afrique, les Caraïbes…Il nous faut des marins, des artilleurs, des fantassins. Avez-vous fait un choix ?
– Non monsieur, pas vraiment.
– Ce n’est pas important pour l’instant. Bien ! …Ma décision est prise. Vous partirez avec le convoi de vendredi en direction de Marseille. C’est un voyage par les canaux aux moyens de chalands. Arrivé à Marseille, vous remettrez à la direction du camp, le dossier que je vais vous préparer et ils vous guideront vers les services concernés. Avez-vous des questions ?
– Non monsieur, merci monsieur !
Franz sort du baraquement soulagé, il s’attendait au pire mais cela s’est bien passé. Auguste est là qui l’attend l’œil interrogateur.
– Alors ?
– Alors ! Je pars pour Marseille et je m’engage dans l’armée.
Tous les deux s’aperçoivent à ce moment-là qu’ils vont se séparer ; que chacun va suivre une route, une destinée différente.
– Pourquoi ce choix ? L’armée, tu n’y connais rien ou presque. C’est vrai que la guerre chez-nous, nous en a donné un aperçu…
– Je ne sais pas en fait. La nuit dernière j’ai repensé aux histoires fantastiques que racontait mon grand-père. Il avait un ami d’enfance qui s’était enrôlé dans les armées de Napoléon, dans les hussards, Georges…, Georges Bangofsky, Sarregueminois comme lui. C’était un vaillant combattant ; il a fait Austerlitz, Jena, Eylau, Friedland, Wagram et la Retraite de Russie. Quand Napoléon est revenu, il a fait la Campagne de France et Waterloo ; 11 campagnes et 6 blessures, un phénomène disait mon grand-père. J’ai pensé à cet homme que je ne connais pas, il faut avoir une sacré force de caractère et physique pour survivre à tout cela. Les gens en parlent encore dans mon pays.
De retour sous leur tente, Nicolas leur fait la surprise d’avoir pensé à récupérer du pain et du lait, car une fois de plus, les convocations à la direction du camp sont synonymes de jeûne matinal. Vendredi c’est demain, il faut se préparer. Il faut prévenir Alexandre, refaire le sac, comment se nourrir pendant le voyage ? Qui va payer ? Les questions fusent sous la tente, l’excitation est à son comble. Chacun sent au fond de lui-même, que la décision qu’ils viennent de prendre aura de lourdes conséquences sur la suite de leur existence, ils parlent en même temps, l’autre n’entend plus rien que son propre monologue. Nicolas assiste à cette scène sans voix, son regard se pose tantôt sur l’un, tantôt sur l’autre.
– Bonjour la compagnie ! C’est Alexandre qui fait son apparition. Alors qu’avez-vous décidé ?
Pêle-mêle, les jeunes gens racontent leur entrevue avec l’homme en noir.
– Du calme mes amis ! L’un après l’autre ; je ne sais plus qui veut être gendarme et qui veut partir pour Marseille. A toi Auguste ! Qu’as-tu décidé ?
– Je veux rester en France. La gendarmerie recrute et je suis d’avis d’y aller. Le monsieur qui m’a reçu va me faire un dossier que je dois présenter à Paris à une adresse qu’il m’indiquera.
– C’est parfait ! Tu ne feras pas le voyage tout seul ; vous êtes une bonne dizaine à avoir opté pour cette solution. Je te présenterai tes nouveaux compagnons demain matin. Et toi Franz ?
– Moi, je suis partant pour l’Afrique du Nord, mais je voudrais m’enrôler dans l’armée. Le responsable du camp m’a dit qu’il me donnera un dossier que je dois présenter à Marseille dès mon arrivée.
– Tout cela est parfait mes amis. Vous avez fait un choix selon vos convictions, sans contrainte. Vos parents seront prévenus, par votre missive, d’ici quelques jours. Auguste ira donc à Paris par le train avec les autres candidats pour la gendarmerie. Franz, tu feras le voyage avec les mariés du camp voisin. Vous serez rassemblés à Vitry-le-François où vous prendrez les chalands. Ne vous inquiétez pas pour la nourriture et l’argent ; pour une fois c’est l’Etat qui paie. Le long des canaux, lors des haltes du soir, de la nourriture vous sera distribuée par l’armée qui a tout organisé. Messieurs, vous allez visiter la France !
– Et moi alors ! S’exclame le petit Nicolas.
– Le sergent ne veut pas ! Reprennent en chœur les trois amis en riant.
– Ne t’inquiète pas Nicolas ! Ton tour viendra bientôt. Le sergent est un brave homme et il veille sur toi. J’ai même cru comprendre qu’il te ramènera à Bordeaux chez-lui. A demain mes amis !
La journée semble particulièrement longue. Plusieurs fois, les sacs ont été vérifiés, défaits, refaits. Franz est parti laver quelques vêtements qui sèchent maintenant sur les cordes de la tente. Auguste s’est lavé deux fois en trois heures de temps et tente désespérément de mettre de l’ordre dans ses cheveux rebelles qui se dressent sur sa tête. Quelques banalités sont échangées, des discussions sans conviction démarrent pour se perdre au profit d’une autre activité subitement importante. Franz et Auguste sont tout simplement malheureux de se séparer. La prochaine nuit sera encore plus longue et plus agitée que cette journée sans fin. Cela fait douze jours que Franz a quitté Sarreguemines.
Ce matin-là, Franz et Auguste étaient debout bien avant le roulement de tambour, le sac prêt au pied du lit. Le petit Nicolas dormait encore. Auguste avait allumé sa dernière chandelle dont la flamme vacillante faisait danser les ombres sur la toile de la tente. Le jour ne voulait pas se lever, comme si le temps freinait les pas de ceux qui allaient se lancer vers une aventure ; l’aventure de leur vie d’homme. Au roulement de tambour, Franz et Auguste seront séparés par le choix d’existence qu’ils ont souhaité. Leur amitié, née dans l’épreuve, était devenue forte. Ensemble, ils ont fait leurs premières expériences d’homme, l’un étant le soutien de l’autre. C’est un petit roulement de tambour qui va mettre fin à leur rencontre.
– Le tambour…C’est le moment, faisons nos adieux maintenant mon cher Auguste, après le rassemblement…Va savoir.
Les deux fugitifs s’étreignent avec une grande émotion, chacun souhaite le meilleur pour l’autre.
– N’oublie pas Franz, Bitche, la famille Muller, tout le monde connaît. Si un jour prochain le retour au pays est possible, tu seras le bienvenu.
– C’est pareil pour toi. Sarreguemines est une grande ville mais tu trouveras. Je suis certain qu’un jour, nous ou nos enfants, nous retournerons dans notre pays. Que Dieu te garde mon cher Auguste !
Puis, tous les deux se dirigent vers le petit Nicolas qui a assisté à cette scène émouvante pour lui faire leurs adieux.
– Adieu Petit Nicolas ! Ne sois pas triste, dans ton grand malheur tu as trouvé un brave sergent qui s’occupera de toi. Suis ses conseils, ce sont les conseils d’un homme qui a vécu.
Ils lui serrent la main, lui tapotent l’épaule puis s’en vont.
– Bonne chance mes amis ! S’écrit Nicolas avec un gros chat au fond de la gorge.
Les hommes sur le départ arrivent vers le lieu de rassemblement. Ils sont reconnaissables avec leur balluchon prêt pour le voyage. Franz en dénombre une bonne vingtaine, de vingt à quarante ans, ils sont robustes, ils gardent la tête haute devant l’adversité. Le sergent invite les partants à se regrouper, un garde les accompagne vers le baraquement de la direction du camp. A l’appel de leur nom, chacun reçoit un dossier des mains de l’homme en noir, avec les recommandations d’usages ; en prendre soin et le remettre aux autorités dès leur arrivée à Marseille. Auguste a regardé son ami s’éloigner, un dernier regard et un petit geste de la main, puis Franz a disparu dans les allées du camp pour marcher vers son destin. Marcher ! C’est bien le mot qui convient. L’homme en noir leur a expliqué qu’ils devront se rendre à pied jusqu’à Vitry, une journée de marche ; c’est là qu’ils embarqueront sur les chalands.
Pendant trois semaines, ils vont ainsi naviguer sur les canaux où la vie s’écoule au rythme de l’ensoleillement de la journée, des pas de l’homme et du cheval. Les familles avec leur marmaille sont entassées sur les chalands où vit, en permanence, un couple de batelier. C’est leur maison. A l’avant du bateau, une grande pièce est aménagée, c’est là que naissent leurs enfants, qu’ils dorment. Les enfants des bateliers sont heureux de rencontrer d’autres enfants pour jouer et rire, c’est si rare pour eux de se divertir ainsi.
Par moment, il n’y a pas de chevaux disponibles pour tirer les embarcations, alors quelques hommes descendent sur le chemin de halage et tirent les chalands d’une écluse à l’autre. Chaque soir, une halte permet aux femmes et aux enfants de descendre à terre, l’armée attend ces curieux voyageurs pour leur servir un repas chaud. C’est ainsi que pendant de longues semaines d’efforts, ces voyageurs s’aventurent au fil de l’eau, toujours plus vers le sud ; l’été se fait sentir maintenant, soleil et vent mettent en condition les futurs colons d’Algérie. Les jours passent, Saint-Dizier, Joinville, Pièpage, Pontaillet-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne, Châlon-sur-Saône, Lyon, où une pause de deux jours donne l’occasion aux femmes de laver linge et enfants. A partir de cette grande ville, il faut attaquer le Rhône, avec des embarcations plus robustes, avec une voile également. Le changement d’embarcations se fait sans problème, et le voyage continue vers le sud sur un fleuve capricieux, dangereux parfois. De Lyon à Arles, surgit tout le passé romain et médiéval, avec ses châteaux, ses ruines, ses tours. Un fleuve au régime complexe qu’il faut apprivoiser au printemps avec la fonte des neiges qui provoque des crues, puis la sécheresse de l’été qui baisse son niveau, puis les eaux de pluies qui provoquent les crues d’automne. Vienne, Andancette, Tournon, Valence, Rochemaure, Avignon, Arles, enfin, où les moustiques se régalent sur la peau claire des gens venant du Nord.
Durant ce voyage, Franz a beaucoup observé ses compagnons. De rudes gaillards, tous Alsaciens ne parlant que quelques mots de français. Plusieurs fois, il a dû intervenir pour que militaires et futurs colons puissent se comprendre. Il est vrai que le dialecte alsacien est très différent du patois de Sarreguemines, mais il comprend. Franz a eu la chance de pouvoir être scolarisé, lois françaises et lois locales, ont fait qu’il est naturellement bilingue. Trois années d’allemand, trois années de français. Un cycle scolaire particulier en fonction des régimes politiques et de l’application des lois. Il le doit également à ses parents qui ont fait l’effort de payer l’instituteur pendant ces six années. Dès qu’un problème apparaît, les têtes se tournent vers Franz, attendant un éclaircissement dans la langue maternelle pour bien comprendre. Au fil des jours qui passent lentement, Franz découvre parmi ses compagnons, d’autres malheurs, d’autres espérances. La guerre les a profondément marqués, quelques-uns fuient les Allemands, d’autres ont tout perdu et, ruinés, ils tentent une nouvelle vie ailleurs, «n’importe où de préférence » comme ils disent. Pratiquement tous vignerons, l’Etat français leurs propose de relancer le vignoble algérien et leur offre des terres immenses. Avec eux, quelques tonneliers, forgerons, charrons, maréchaux-ferrants, bourreliers, tous ces métiers nécessaires pour cette grande entreprise.
Le temps ne manque pas pour songer au passé ou rêver de l’avenir. Un homme est assis sur le bord du chaland et sculpte dans un morceau de bois, une cigogne qu’il destine à une petite fille. Assise devant lui, elle attend patiemment que l’œuvre soit terminée. Dans les yeux de l’enfant, Franz semble deviner le bec rouge-orangé de l’animal, son plumage noir et blanc. Il entend même craqueter l’échassier ; un migrateur comme eux.
Cela fait bientôt trois semaines que Franz navigue ainsi avec ses compagnons. L’inactivité physique laisse le temps à l’esprit de divaguer ; il pense souvent à ses parents, à ses petites sœurs, à ses amis de la faïencerie…Parfois des regrets, souvent plein d’espoir, ses pensées naviguent de l’un à l’autre. Il a beaucoup de difficultés à imaginer cette terre d’Algérie. Les personnages qui défilent dans sa tête sont des cavaliers armés qui font la guerre. En fait, il ne voit que les images décrites par son ami Jean.
Un après-midi, une activité inhabituelle règne sur les embarcations et sur les berges. Un gendarme à cheval hèle le batelier et le somme de s’amarrer. Au loin, une des embarcations est déjà amarrée et les voyageurs se regroupent en famille sur le chemin de halage. A quelques pas de là, sur un chemin, une dizaine de coches sont à l’arrêt. C’est la première fois que Franz voit ce genre de transport. Les coches des postes sont attelés à six chevaux robustes. Une masse imposante qui peut transporter douze personnes, neuf à l’intérieur et trois sur une banquette, à l’arrière, au-dessus d’un porte-bagages. Une capote peut être pliée ou dépliée à volonté, pivotant sur deux axes reliés par des arceaux. Deux hommes manœuvrent le monstre ; le cocher, armé d’un grand fouet est assis au-dessus des chevaux et de l’habitacle des passagers. Le deuxième homme, le postillon, est en selle sur l’un des chevaux de tête et guide l’attelage.
– Qui, parmi vous s’appelle Franz ? C’est un gendarme à cheval qui pose cette question.
– C’est moi monsieur !
– Suivez-moi avec vos bagages.
Franz s’exécute. Arrivé à hauteur du premier chaland, le gendarme présente Franz à ce qui semble être son supérieur.
– Bonjour jeune homme. Je suis l’adjudant Dubois chargé de votre embarquement et de votre transport par diligence sur Marseille. Nous avons un petit problème avec les réfugiés du premier bateau ; personne ne parle français et nous n’arrivons pas à nous faire comprendre. Pouvez-vous nous aider ?
– Bien sûr monsieur…Que faut-il leur dire ?
– Dans un premier temps, il faut leur expliquer que le restant du trajet est fait par la route, jusqu’à Marseille. Qu’ils montent dans les diligences avec les bagages par groupe de douze.
Franz explique à ses compagnons comment se déroule la suite du voyage. Un énorme brouhaha s’en suit immédiatement. L’inquiétude se lit sur les visages des femmes, la colère sur le visage des hommes. L’adjudant qui craint le pire, rappelle ses hommes.
– Alors Franz, c’est quoi le problème ?
– Ils ont peur d’être séparés. Par groupes de douze, certaines familles vont être dans différentes voitures. Les enfants veulent rester avec leur mère, les hommes ne veulent pas être séparés de leur femme.
– Je ne peux pas mettre une diligence par famille, tout de même ! Il faut être raisonnable ! De toute manière, il y aura un deuxième départ demain. Les relais de poste ne peuvent pas fournir autant de chevaux. Il faut que les bêtes se reposent…
L’Adjudant cherche une solution. Son visage s’éclaire : Il a trouvé.
– Franz ! Voilà comment nous allons procéder : Rassemblement par familles séparées de deux pas entre-elles. Par complément de douze, nous allons former les groupes au sol. Par exemple, une famille de quatre, plus une famille de six et un couple sans enfants. Cela fait douze. Les derniers, demain, feront un effort de compréhension.
Franz expose les directives de l’adjudant et pour être sûr d’avoir été compris, il forme le premier groupe de douze personnes. Rassurés, les Alsaciens se rassemblent par famille et par affinité. Le calme revient. Les premières familles embarquent avec marmaille et bagages, l’adjudant presse les voyageurs car il faut être au relais de poste avant la nuit. Demain soir, les premiers seront à Marseille dans un camp de transit où sont rassemblés les futurs colons avant l’embarquement sur les navires en partance pour l’Algérie. Franz est à nouveau sollicité par l’adjudant Dubois.
– Demain matin, d’autres diligences arriveront pour récupérer ceux qui restent. Je laisse deux gendarmes avec vous pour vous escorter. Je vous demande comme un service de rester avec ce dernier groupe pour faciliter la tâche de mes hommes.
– Bien sûr, monsieur !
– Merci Franz ! J’ai beaucoup apprécié votre aide. Et bonne chance !
Dans un nuage de poussière, le petit groupe de gendarmes s’éloigne au galop pour rattraper les diligences qui ont déjà disparu de l’horizon. Ceux qui restent, s’installent pour une nouvelle nuit à la belle étoile.
Le lendemain matin, le soleil a déjà entamé sa courbe dans le ciel depuis quelques heures, quand les diligences arrivent enfin. L’un des cochers explique aux gendarmes qu’un problème de moyeu a ralenti la progression, qu’un cheval a perdu un fer, que le mistral souffle de travers…Bref ! Les futurs colons sont bien arrivés dans le Sud. Les conciliabules de la veille au soir ont déjà déterminé la composition des groupes, l’embarquement se fait donc rapidement et Franz prend place dans le dernier coche. Bien que suspendues, les diligences ne sont pas confortables. Pendant des heures, les chaos de la route font vibrer les occupants de la tête aux pieds; le moins que l’on puisse dire c’est que cette partie du voyage est plus remuante que les chalands se déplaçant au fil de l’eau. De relais en relais, les changements de montures sont les seuls instants de répit pour les voyageurs. Parcourir une vingtaine de lieues dans la journée dans ces conditions devient une torture. La nuit, bien que tardive à cette époque de l’année, enveloppe déjà les voyageurs. Les paysages disparaissent, seule la lueur d’une lanterne à côté du cocher donne la vision diffuse d’une vie dans cette obscurité épaisse, couleur d’encre. Soudain, les montures ralentissent. Au loin, on devine quelques lumières qui semblent venir d’habitations. Les chevaux sont au pas, puis, s’arrêtent devant une barrière où un homme en arme, une lanterne à la main, s’approche de la première diligence. Un deuxième soldat fait son apparition et monte à côté du cocher, la barrière s’ouvre et le convoi s’engouffre dans une grande allée. Franz devine des baraquements, dans certains, la lumière fait danser des ombres à travers les vitres. Le convoi s’arrête enfin. Les gendarmes font descendre tous les voyageurs avec leurs bagages, des soldats apparaissent et ouvrent les portes des baraquements, des lanternes s’allument partout, des éclats de voix fusent dans la nuit. C’est la fin d’un long voyage à travers la France. Comme ses compagnons, Franz est fatigué, las de ces mouvements, épuisé par ces routes chaotiques. Il n’a qu’une envie : dormir. En entrant dans le baraquement qui lui est destiné avec six autres compagnons, célibataires comme lui, il a l’agréable surprise de constater qu’il y a douze lits avec matelas et couverture, et au milieu de la pièce un poêle à charbon dont le long cou noir s’élance jusqu’au toit. Une lanterne, accrochée à une chaînette, pend du plafond et éclaire la pièce Le premier lit qu’il rencontre est le bon ; il laisse tomber son baluchon à terre et son corps de tout son long sur le matelas, vidé. Pendant quelques instants encore, il perçoit les bruits d’une discussion au lointain, puis, ses paupières lourdes luttent un petit moment avant de céder à un sommeil profond et réparateur qui le plonge dans les bras de Morphée.
Une sonnerie de clairon fait sursauter la chambrée. La nuit a été courte et personne ne semble vouloir se précipiter. La porte s’ouvre et « quelque chose de flou » hurle dans la pièce un vigoureux « debout là-dedans ! ». Franz décide enfin à bouger ce corps meurtri pour aller aux nouvelles. Malgré l’heure matinale, le soleil dispense déjà ses rayons chauds à travers de grands arbres dont il apprend que ce sont des pins parasols. Arbre étrange, où les cigales stridulent du matin au soir et dont le tronc tordu semble vouloir fuir dans tous les sens, les branches couvertes d’épines, qui poussent à l’horizontale, étalent une ombre bienfaisante. Des arbrisseaux à petites fleurs jaunes dispensent quant à eux, une agréable odeur. Franz découvre cette végétation nouvelle. L’environnement est véritablement paradisiaque ; pins, genêts, lauriers roses, le soleil, les oiseaux de toutes sortes et au loin, très loin sur l’horizon, il lui semble voir la mer.
La mer, tous en parlent depuis quelques jours. Personne ne l’a vue, et les enfants, effrayés, écoutent les histoires incroyables de monstres marins qui avalent les bateaux des pêcheurs d’un seul coup. L’Alsace, la Lorraine, c’est bien loin de la mer ou de l’océan. Il est difficile d’imaginer l’étendue, la puissance de ces continents liquides, pour quelqu’un qui pêchait parfois au bord de la Sarre ou sur les bords du petit ruisseau qui traverse le village natal.
Dans la vallée, au loin, il lui semble apercevoir une ville qui tend ses bras ouverts à cette mer, dans un geste ample, donnant l’impression de vouloir accueillir le monde entier. Des collines blanches entourent la ville d’une barrière protectrice, mettant la ville à l’abri des affres des guerres, des épidémies. Il doit faire bon vivre dans cette ville ; c’est sans doute Marseille.
– Faut pas rêver mon gars ! Le rassemblement c’est de l’autre côté !
Franz revient à la réalité et il a un instant d’hésitation avant de se diriger vers l’endroit désigné par le soldat qui l’a arraché à sa rêverie. Il retrouve ses compagnons de voyage dans un état de fatigue et de saleté repoussante. L’arrivée de nuit, la fatigue, personne n’a fait de toilette, personne n’a mangé. Les traits des visages sont tirés, les habits poussiéreux n’ont plus de couleurs, la faim torture les estomacs, les enfants pleurent. A la vue de ce spectacle de désolation, les militaires proposent un petit déjeuner avant de faire l’appel et de donner les consignes pour la journée. Café, lait chaud, boule de pain, c’est l’abondance, les pleurs cessent et les estomacs se calment. Tout en mangeant, Franz inspecte du regard les environs immédiats du cantonnement. Il hèle un soldat pour lui demander le nom de l’endroit où il se trouve.
– T’es dans le camp de Sainte-Marthe, près de Marseille, mon gars !
Le camp, sur les hauteurs Nord de Marseille, est un ensemble de baraquements alignés de part et d’autre d’une grande allée qui mène vers le château du propriétaire des lieux ; un certain Frantz Major de Montricher. Sur les 23 hectares, il en avait fait un domaine agricole prospère, mais dû en céder une partie par réquisition à l’armée. Arbres et fleurs sont en abondance et les gigantesques pins protègent les baraquements des rayons ardents du soleil de la méditerranée. D’autres bâtiments sont en construction, les cuisines qui viennent d’être mises en service, avec des réfectoires immenses. L’ensemble est en mesure de satisfaire en nourriture huit cents hommes simultanément. Un hôpital est déjà en activité pour des soins et contrôles avant l’embarquement sur les navires. Le camp de Sainte-Marthe est destiné à accueillir les militaires en transit vers les colonies d’Asie et d’Afrique et pour la première fois à l’accueil des réfugiés venant de l’Est de la France. Franz déambule dans le camp, engage de courtes discussions avec les soldats pour s’informer sur l’endroit, sur Marseille, sur le départ pour l’Algérie…Les bâtiments se ressemblent tous et il a un moment d’hésitation avant de retrouver le sien. En passant devant l’hôpital, il a remarqué une bâtisse tout en longueur avec des inscriptions « Bains officiers, bains troupes ». Franz informe ses compagnons de chambrée de sa découverte et s’apprête à partir quand un soldat entre dans la pièce.
– Le dénommé Franz, est-il ici ?
– Oui ! C’est moi.
– Il faut me suivre chez le commandant du camp.
– Nous sommes dans un état lamentable, une toilette me semble indispensable pour être présentable. Pourriez-vous nous escorter jusqu’au bâtiment des bains.
Le soldat, surpris par la demande de Franz, consent à les escorter pour la toilette. Heureux comme des gamins, Franz et ses compagnons suivent le soldat qui ne se rend pas compte qu’il vient d’être manipulé pour officialiser le droit d’accès aux bains. Effectivement, aucun gradé ne s’oppose à l’entrée de ces civils dans le bâtiment « Bains » puisque sous bonne escorte et sous l’autorité de l’armée.
– Bien joué ! Dit en alsacien l’un d’eux.
Lavé, rasé de près, vêtements brossés et chaussures décrottées, Franz se présente devant le commandant du camp. L’homme est âgé, son bras gauche pend le long du corps et semble inerte, une vieille blessure sans doute. Sur sa poitrine, quelques décorations dont les rubans de couleurs ont terni au soleil, son visage maigre disparaît de moitié derrière une épaisse moustache et une barbe fournie.
– Franz Rheinhardt ! Avez-vous le dossier établi par les services aux réfugiés de Mailly ?
– Oui monsieur ! Voilà…
– Je suis capitaine…Appelez-moi mon capitaine !
– Oui mons…Mon capitaine !
– Asseyez-vous, je vais consulter ce dossier à l’instant même.
Le capitaine lit le rapport qu’il vient de décacheter en hochant la tête et en marmonnant dans sa barbe des « Oui…Oui », « Ah ! », « Bien ». Ce qui inquiète beaucoup Franz qui ne connaît pas le contenu du rapport en question. Après un moment, le capitaine lève la tête et semble souriant.
– C’est très bien ! Vous exprimez le désir de servir la France sous l’uniforme de l’armée. C’est un très bon choix. Honneur, fidélité, camaraderie, les combats, le drapeau…
Pendant un bon quart d’heure, le capitaine explique au jeune lorrain tout ce que l’armée a de plus beau, ses valeurs et bien entendu les devoirs du soldat.
– Je vous conseille l’infanterie. Volontaire pour les chasseurs d’Afrique, vous aurez rapidement du galon. Qu’en pensez-vous ?
– C’est certainement une bonne solution mon capitaine, les célibataires réfugiés comme moi, n’ont aucune subvention pour s’installer en Algérie. C’est pourtant là que je désire m’installer.
– Faites-moi confiance, jeune homme, vous partirez bientôt en Algérie.
Sur ces propos, le capitaine appelle un planton qu’il charge de guider Franz vers le major du camp pour les formalités d’engagement. Formalités simples, visite médicale, perception d’un équipement de base pour jeune recrue chez le fourrier, nouveau bâtiment dortoir avec d’autres jeunes. Tout va très vite, Franz est devenu militaire en un tour de main.
Quelques jours plus tard, il voit partir ses anciens compagnons avec qui il a traversé la France pendant près d’un mois de voyage ininterrompu. C’est la troisième fois en très peu de temps que Franz quitte ainsi brutalement, sa famille, ses amis, ses compagnons. Il pense à ses parents, ses petites sœurs, là-bas, très loin vers l’Est. Il pense à Auguste qui doit-être gendarme désormais, et à ce brave Jean qui les a mis sur la bonne route avec de très bons conseils. Une fois de plus, le voici seul, en marche vers une nouvelle vie, une vie de soldat et d’aventures avec tout ce que cela comporte comme dangers, joies et misères.
Pendant deux mois, il fait ses « classes ». Marcher au pas, tirer au fusil, instruction avec marche sans fin dans les garrigues, des nuits sans sommeil, des gardes…Le métier de soldat est rude mais il y a aussi de bons moments avec ses camarades. Il apprend la solidarité, la camaraderie franche, l’effort physique, le soutien moral n’est pas un vain mot pour ces jeunes livrés à eux-mêmes. Franz découvre un autre univers et se sent bien dans ce milieu qui convient à son caractère.
Pour la première fois, il touche son prêt-franc ; quelques sous qu’il décide d’utiliser pour écrire à ses parents. Le vaguemestre fournit le nécessaire, y compris les timbres et assure l’acheminement des missives. Chose à laquelle il n’a pas songé : l’adresse de ses parents. Le jour même où il a posté son courrier, il est convoqué dans le bureau de l’officier de sécurité militaire.
– Rheinhardt ! Pouvez-vous m’expliquer pourquoi vous écrivez en pays ennemi ?
Le sang de Franz ne fait qu’un tour. Il a subitement des envies de meurtre et songe un instant à sauter au collet du lieutenant. Mais, il se calme rapidement.
– J’écris à mes parents, mon lieutenant. Il se trouve qu’ils habitent dans un pays que la France n’a pas su conserver.
Le lieutenant devient cramoisi, il a le souffle coupé par les propos insolents de ce jeune soldat. Pendant un moment il ne trouve pas ses mots.
– Votre insolence va vous coûter quelques jours de prison. Présentez-vous immédiatement chez le sous-officier de service pour être incarcéré.
Franz salue réglementairement l’officier, fait demi-tour et s’en va satisfait d’avoir mouché ce blanc bec de lieutenant. Deux jours plus tard, il retrouve la liberté, juste à temps pour la fin des « classes ». Le commandant d’unité, au cours du rassemblement de fin de journée, annonce les résultats des derniers exercices et la promotion des deux premiers au grade de caporal.
– Sont promus au grade de caporal, le soldat Dufour de la première section et le soldat Rheinhardt de la deuxième section ! Dufour et Reinhardt sortez des rangs…Voici vos galons…Félicitations !
Franz ne peut s’empêcher de lancer un regard au lieutenant qui reprend la même couleur cramoisie que lors de leur première rencontre. Les « classes » étant terminées, le capitaine accorde deux jours de permission à la compagnie d’instruction. Pour fêter ses galons, Franz décide de mettre à profit ces deux journées pour faire connaissance avec cette ville dont il a tant entendu parler, Marseille. Avec deux de ses camarades, ils décident de profiter d’une des liaisons permanentes avec les subsistances militaires qui, chaque matin de très bonne heure, effectue le trajet pour approvisionner le camp en vivres frais. Le lendemain matin, bien avant l’appel du clairon, ils attendent au poste de sécurité le passage du charroi de liaison. Sans problème, le caporal responsable du transport accepte les trois permissionnaires. Une heure plus tard, Franz arrive, avec ses deux camarades, à Marseille.
Si tôt le matin, la ville est encore endormie. Quelques rares passants arpentent les longues avenues pentues qui descendent vers la mer. Avant l’arrivée au port, une très grande allée avec des ateliers de cordage, de chanvre qui sèche, de montagnes de cordes tressées, puis soudain, l’odeur du poisson et la mer. Des pêcheurs revenant du large, déchargent leurs prises des petites embarcations ; les femmes trient le poisson sur les étals tout près du bord et s’interpellent en donnant des appréciations sur la qualité des poissons attrapés par leurs époux. S’en suivent des réponses dans un langage fleuri que seul les méridionaux savent manier. Dans le port, sont arrimés une multitude de bateaux de toutes tailles. De grands voiliers, les pointus des pêcheurs, des petits vapeurs, d’innombrables embarcations qui font penser aux voyages et à des aventures vers les terres lointaines d’Asie, d’Afrique ou des Amériques. C’est la première fois que Franz voit la mer de si près. Il est surpris par ce mélange d’odeurs que son nez ne reconnaît pas ; décidément, après les parfums de la garrigue et des pinèdes, les effluves de la mer sont une nouveauté. Un café, situé juste en face du port, s’anime. Franz propose à ses compagnons de boire quelque chose de chaud avant de partir à la découverte de la ville.
– Alors beaux militaires ! Un petit jus ? Ca vous changera du jus de chaussettes de l’intendance.
– Avec du lait s’il vous plait monsieur !
– Peuchère ! Ils tètent encore leurs mères, ils ne sont pas sevrés ces soldats. Cécile ! Trois cafés… au lait.
En buvant son café au lait, Franz aperçoit à travers les vitres, une colline, juste en face, avec une église surmontée d’une statue dont il ne devine que vaguement les contours. Il demande une explication au garçon.
– C’est quoi cette église sur la colline ?
– Premièrement, ce n’est pas une église ; c’est une cathédrale. Vous voyez Marseille sans cathédrale ? Ensuite, l’année dernière, nous y avons installé la statue de la Bonne Mère, il paraît même qu’ils vont la recouvrir d’or.
– Ah !…
– Fallait bien ça pour la Bonne Mère. Après la Révolution de 1789, toutes les églises ont été dévastées. Même qu’à un moment il avait débaptisé la ville… « Ville sans Nom », qu’ils ont appelé Marseille… « Ville sans Nom »…Marseille…Ils étaient fadas ! ».
Les histoires du garçon de café font bien rire les trois jeunes soldats. Sa façon de s’exprimer, de mettre ses phrases en images avec mille détails et gestes pour ponctuer ses dires, est un régal pour les oreilles et pour les yeux.
Le soleil éclaire maintenant toute la ville, ses premiers rayons chauds effleurent agréablement le visage. Les trois gaillards décident d’aller au bain de mer vers la sortie de la ville. La première surprise, est que la ville est grande et c’est après une bonne heure de marche qu’ils trouvent enfin un endroit à leur convenance. La deuxième surprise, est que l’eau est très fraîche à cette heure matinale. Tant pis ; pour cette première prise de contact avec la Méditerranée, ils se jettent à l’eau avec de grands cris pour conjurer les effets du saisissement de cette eau froide sur la peau. Par contre, se sécher aux rayons chauds du soleil est un ravissement et, tantôt sur le dos, tantôt sur le ventre, les trois jeunes gens se laissent aller à leurs rêveries sans parler, profitant de cet instant que la vie leur offre.
Pendant deux jours, ils vont ainsi découvrir non seulement la ville, mais aussi la vie. Cafés, spectacles de rues, dans les petites ruelles sombres du soir, des filles de joies proposent de faire don de leur corps à l’armée française, une aventure que Franz désirait depuis un bon moment et que son corps réclamait avec de plus en plus d’insistance. La fille était bien jeune, elle avait un sourire permanent, était bien faite, mais avec une tristesse dans le regard. Rapidement elle met le jeune puceau à l’aise avec des mots simples et des gestes de femmes du métier ; le plus vieux métier du monde dit-on. C’est ainsi que Franz est devenu, ce soir-là, définitivement un homme. A la fin de la deuxième journée, les trois compagnons décident d’écourter leur permission, faute de moyens financiers. Le chemin du retour vers le camp de Sainte-Marthe est particulièrement long, la nuit est installée depuis un bon moment quand enfin ils arrivent devant la barrière où une sentinelle veille déjà sur la sécurité du camp.
Le lendemain matin, au cours du premier rassemblement de la journée, Franz apprend qu’il est affecté dans une unité de l’armée d’Afrique et que le départ est fixé deux jours plus tard. Responsable d’un petit détachement, il est chargé de la discipline des soldats à bord du bateau et de remettre aux autorités militaires du port d’Alger, les dossiers que le commandant du camp va lui remettre. Tout va très vite, il rassemble ses affaires, élimine le superflu, tente de faire rentrer dans son havresac l’ensemble de son matériel réglementaire et personnel. Tout est prêt. Un porte-documents en toile lui a été remis avec les dossiers, il perçoit une petite somme d’argent qui est, en fait, sa prime à l’engagement et que les autorités militaires ne remettent aux soldats qu’après la période de « classes » pour éviter les chasseurs de primes qui disparaissent dans la nature avec de l’argent facilement gagné. Il pense maintenant à écrire à ses parents pour les avertir de ce nouveau départ. Ce soir-là, Franz veille très tard avec comme seule présence, une lanterne qui éclaire une lettre de plus en plus longue. La chaleur lourde des soirs d’été du Sud a disparu et une petite fraîcheur se fait sentir ; il doit-être très tard. Franz s’endort enfin.
Le petit détachement, sous les ordres du caporal Rheinhardt, quitte le camp de Sainte-Marthe en convoi militaire vers le nouveau port d’embarquement de La Joliette où les grands vapeurs modernes appareillent désormais pour le large. Il doit se présenter au quai d’Honneur où est amarré le vapeur Province d’Oran, C’est sur ce navire qu’il va rejoindre le continent africain. Avant de quitter Marseille, Franz a acheté un carnet et quelques crayons avec la ferme intention de noter chaque jour les faits marquants de sa nouvelle existence ; il note donc sur la première page :
Marseille le 12 septembre 1871. Port de La Joliette. 9 heures du matin.
Embarquement sur le Province d’Oran à destination d’Alger.
Il ne le sait pas, mais ce carnet aura beaucoup d’importance pour ses arrière-petits-enfants qu’il ne connaîtra pas, mais qui se souviendront ainsi de leur origine lorraine.
En mer, le 13 septembre 1871.
Installé au plus profond du navire, la chaleur est étouffante.
A ma demande, nous avons le droit à une heure de promenade sur le pont le soir.
15 septembre 1871.
Fin d’après-midi. Nous arrivons en vue d’Alger.
Franz rassemble ses hommes et ensemble ils montent sur le pont pour assister au spectacle de l’arrivée dans le port d’Alger. D’autres voyageurs font de-même, des émigrés qui vont tenter l’aventure d’Afrique du Nord. Trois coups de canon sont tirés de la forteresse pour annoncer l’arrivée de nouveaux colons ; la population ainsi avertie est invitée à venir les accueillir. Sur le quai, une fanfare militaire joue des marches entraînantes, un haut fonctionnaire prononce un discours de bienvenue à des colons qui ne parlent pas français puisque originaires du Bade allemand et de Suisse. Franz a eu l’occasion d’échanger quelques mots avec eux. Un adjudant, muni d’un porte-voix et d’une liste, tente de faire l’appel des nouveaux venus. Un charroi militaire les attend, femmes et enfants se hissent dans les véhicules, les hommes iront à pied faute de places. Franz regarde songeur ces pauvres gens qui vont se lancer dans une nouvelle vie, rude et incertaine. Combien survivront au climat, aux maladies, au difficile métier de la terre ?
Un sergent s’approche de Franz et de son groupe.
– Bonjour caporal et bienvenue en terre d’Afrique !
Franz salue réglementairement le sous-officier,
– Je suis le sergent Deschamps de l’Etat-major, je vais vous guider jusqu’au cantonnement ; suivez-moi avec vos hommes !
Pas très loin du port, des bâtiments imposants, gardés par des soldats en arme, abritent vivres et matériels militaires. Une de ces bâtisses de briques rouges a été aménagée pour le transit des soldats en attendant une liaison avec leur future unité. Franz remet le porte-documents en toile, avec les dossiers, au sergent-major du bureau administratif, qui l’informe qu’il est interdit de quitter le cantonnement et d’aller dans la ville. Il s’installe donc dans le grand dortoir où une bonne centaine de soldats sont en attente d’affectation et note dans son carnet ses premières impressions en terre africaine. La chaleur n’est pas vraiment plus élevée qu’à Marseille, mais un vent chaud dessèche la gorge et rend la langue plus épaisse. Des odeurs plus pimentées flottent dans l’air, odeurs qu’il n’arrive pas encore à reconnaître.
Tôt, le lendemain matin, un planton vient le chercher pour le présenter à l’officier responsable des effectifs. Il apprend qu’il est affecté dans une unité de chasseurs d’Afrique dont les cantonnements se trouvent à Sidi-Ferruch, à l’ouest d’Alger. Franz doit se présenter à l’entrée principale du bâtiment « E » où un convoi d’approvisionnement doit partir avant midi pour Sidi-Ferruch. Ce nom lui dit quelque chose…Sac à dos, il se dirige vers le lieu indiqué où plusieurs dizaines de soldats chargent sur des chariots, des caisses, des fûts, des casiers en osiers…Il s’adresse à un caporal pour s’informer de la destination des chariots.
– Salut compagnon ! Je dois me rendre à Sidi-Ferruch, c’est bien ce convoi ?
– Eh oui ! Dès que le dernier chariot est chargé, on part, camarade.
– C’est loin d’ici ?
– A peine deux heures !
– Sidi-Ferruch ; ça me dit quelque chose mais je ne me rappelle pas quoi ?
– C’est là que les troupes françaises ont débarqué en 1830…C’est d’où ton accent ?
– Je suis Lorrain. Mon nom est Franz.
Une heure plus tard, c’est le départ. Franz prend place sur le chariot du caporal pour pouvoir discuter plus librement des conditions de vie dans sa future unité et dans le pays en général.
– Je m’appelle Antoine, de Niort. Cela fait trois ans que je suis en Algérie. Le 16 mars dernier, j’ai été blessé à la cuisse lors de l’attaque des « Moqrani » sur Bordj-Bou-Arréridj. Un sacré combat ! Ils nous sont tombés dessus avec plus de trois mille cavaliers. Après ma convalescence j’ai été affecté aux subsistances. Une bonne planque, je ne manque de rien.
– C’est qui les « Moqrani » ?
– Les « Moqrani ! Ce sont des Kabyles. Moqrani est en fait le nom du bachaga, grand féodal du Constantinois et allié du cheikh El-Haddad qui a proclamé la guerre sainte. Mais le cinq mai, Moqrani a été tué à l’Oued Soufflat. C’est son frère, Bou Mezrag Moqrani qui continue la lutte. Avec la fin de la Commune de Paris, nous avons reçu des renforts importants, surtout en armement lourd. A mon avis, il ne tiendra pas très longtemps.
– Si je comprends bien, les combats se poursuivent !
– T’inquiète pas le bleu ; t’auras ta part. Inch’Allah !
– Avec les colons, l’armée a de bons rapports ?
– Tu parles ! Ils comptent sur nous pour leur sécurité. Ils réclament des garnisons partout, un peu plus, il faudrait mettre un soldat derrière chaque colon. Les trois-quarts ne sont pas d’origine française ; des Espagnols, des Italiens, des Maltais, quelques méridionaux et depuis la fin de la guerre avec la Prusse, des Alsaciens et des Lorrains.
– Et les indigènes. ?
– C’est encore plus compliqué. Les Arabes et les juifs cohabitent depuis des siècles, sans problème ; les juifs sont dans le Nord de l’Afrique depuis au-moins trois mille ans, bien avant les Turcs qui ont envahi le pays au VIIème siècle. Puis, au XVème siècle, une grande immigration de juifs espagnols, fuyant l’Inquisition, sont venus grossir les effectifs. On les appelle « les Français Crémieux » suite au décret qui donne la citoyenneté française aux juifs d’Algérie. Les Arabes ne comprennent pas pourquoi la France les laisse sur le bord de la route. Je crois bien que les révoltes aient leur source dans cet état de fait.
– C’est terrible quand ton pays est envahi par une armée étrangère…J’en sais quelque chose. Encore une question ; quand j’étais à l’école, je n’ai jamais entendu parler de l’Algérie. L’instituteur disait « le Nord de l’Afrique. »
– Ah oui ! L’Algérie, en tant que pays, c’est quelque chose de très récent. C’est une création française avec trois départements, même le nom a été inventé. C’est un polytechnicien du nom de Schneider, un haut-fonctionnaire du Ministère de la Guerre, qui en 1839, a imposé le nom d’ « Algérie » dans les correspondances officielles.
– Tu m’as l’air bien informé sur ce pays !
– Je n’ai pas de mérite ; à l’hôpital d’Alger, un lieutenant lui aussi blessé, ancien instituteur avant la guerre, passait son temps à nous faire l’école et nous racontait l’Histoire de France et d’Algérie. Un drôle de bonhomme ; blessé à la tête, il nous prenait pour ses écoliers.
Franz écoute tout en regardant le paysage autour de cette route côtière. La mer, le ciel bleu, la chaleur des pays du Sud, comment un si beau pays peut-il être en guerre ? Après deux heures de route, le convoi arrive en vue d’un fort au-dessus duquel flotte un drapeau tricolore. L’ensemble est bien gardé, de nombreuses sentinelles se déplacent derrière les murs crénelés. Une trentaine de pas devant l’entrée unique, un barrage de chevaux de frises et de sacs de terre, sert de sas pour le contrôle des visiteurs. Deux soldats en arme contrôlent les arrivants, tandis que deux autres, en position de tir derrière des sacs de terre, leurs assurent une protection. L’ensemble des fortifications s’étend sur une grande surface, sur le seul mouvement de terrain des alentours. Des cavaliers sortent au trot et semblent partir en patrouille. Le convoi s’engouffre dans le fort pour se ranger au fond d’une immense place.
Sur les recommandations de son camarade Antoine, Franz se présente chez le sergent-major pour lui remettre sa feuille de route et d’affectation. Le sous-officier est un rude gaillard, la quarantaine probablement, il est évident qu’il n’a pas toujours été un « administratif ». D’une taille au-dessus de la moyenne, crâne rasé, une fracture a mis son nez en virgule vers la gauche du visage qui est marqué d’une cicatrice allant de l’oreille droite à la base du menton. Franz est surpris par la masse imposante de l’homme, mais aussi par sa petite voix fluette qui ne lui correspond pas. Avare de mots, il dit simplement :
– Vous êtes affecté à la première section de la première compagnie. C’est l’élite du bataillon et j’espère que vous serez digne de vos anciens. Toujours à la pointe du combat, ils ont beaucoup de pertes, vous remplacez le sergent Parisot qui vient d’être grièvement touché. Rompez !
La froideur de l’accueil glace les veines du pauvre Franz qui se demande si son idée de devenir soldat est vraiment bonne. Il sent les gouttes de sueur perler sur son visage, sa gorge est sèche et son havresac subitement trop lourd, ses genoux lâchent et il suit péniblement le planton qui le guide vers le cantonnement de la première section.
– Caporal Reinhardt, à vos ordres mon adjudant !
– Repos Reinhardt ! Mon nom est de Kerpezdron, vieille noblesse bretonne échouée sur les côtes africaines. Prends cette chaise…et raconte-moi ton histoire ; j’aime bien connaître mes hommes et savoir à qui j’ai à faire.
Franz se retrouve assis avec son sac sur le dos, surpris par l’attitude de son chef, il hésite un instant avant de débuter son histoire. L’adjudant lui fait signe de poser son sac et se plante à deux pas de Franz en le fixant intensément du regard. L’homme est petit, court sur patte, les épaules larges, ni maigre, ni gros. Ses bras semblent trop longs pour sa taille. Une tête ronde, les cheveux châtains foncés de la même couleur que ses yeux, la trentaine bien faite.
– Alors ! J’écoute.
– Je suis Lorrain…
Puis Franz se met à narrer son histoire. Sarreguemines, les Prussiens, Mailly, le voyage vers Marseille, son engagement dans l’armée, ses espérances, la reconquête de sa Lorraine… Curieusement, le jeune caporal se sent en confiance avec cet homme et il se confie sans retenue. L’adjudant l’écoute sans l’interrompre. Après un long moment, l’aventure de Franz s’arrête dans ce fort parmi ces guerriers qui, bien que très jeunes, ont déjà un passé lourd de faits d’armes et de combats.
– C’est bien mon garçon ! Dans quelques jours, nous partons en opération vers le sud du pays. Il reste encore des « Moqrani » dans la nature et il faut les éliminer pour la sécurité de tous. Désolé, mais tu n’auras pas le temps de t’acclimater et de faire connaissance avec le reste de la section, les anciens vont t’aider à t’installer et te mettre au courant des habitudes de la maison. Tu prendras le commandement du groupe du sergent Parisot qui vient d’être blessé.
Tout va très vite pour Franz. L’enchaînement rapide des évènements depuis son départ de Sarreguemines lui fait tourner la tête, il ne peut plus réfléchir, organiser sa vie, penser à l’avenir. Heureusement qu’il note dans son carnet les moments les plus importants, ce sont les seuls instants de réflexion qu’il lui reste.
Sidi-Ferruch, 16 septembre 1871.
J’ai fait la connaissance de mes nouveaux compagnons. Une impression de grande solidarité règne dans cette unité. Je suis bien installé et le climat est supportable en cette période de l’année…
Sidi-Ferruch, 20 septembre 1871.
Nous partons en opération à la poursuite des rebelles.
Une longue colonne de chariots avec vivres et munitions s’ébranle au petit matin sur la route côtière en direction de l’Est. La compagnie doit escorter ce convoi dans un premier temps jusqu’à Béjaïa pour ravitailler les postes. La première partie de la mission se fera à cheval. Ensuite, en bon lignard, direction le Sud, à la poursuite des rebelles. Dans la région qu’ils traversent, les combats ont été rudes depuis le mois de mai et les traces sont encore visibles. Les villages ont été rasés, les récoltes détruites. Durant tout l’été, des affrontements meurtriers se sont déroulés dans les escarpements des Ziban, de Jijel à Béjaïa ; Bou Mezrag Moqrani a opposé une résistance féroce aux colonnes françaises qui sillonnaient les hauteurs et fouillaient les grottes. Les Kabyles sont de rudes guerriers et Franz ne va pas tarder à s’en apercevoir.
Après cinq jours de marche vers le sud, un matin, au moment même ou le soleil perce l’horizon, des coups de feu sont tirés sur le bivouac et bientôt des cavaliers font leur apparition en poussant des cris stridents. Le campement va être attaqué ; c’est le branle-bas. L’agitation des chevaux ennemis et le remue-ménage du bivouac en effervescence, soulèvent une poussière épaisse, les ordres fusent, chacun prend position à son emplacement de combat. La troupe, bien entraînée, sans panique, est rapidement prête à l’affrontement. Franz est surpris, il se trouve dans une situation toute nouvelle pour lui. Ses compagnons ont déjà l’expérience du combat et ils observent leur nouveau chef de groupe avec un peu de malice dans le regard. La voix de l’adjudant de Kerpezdron se fait entendre.
– Les chefs de groupes…à moi !
En quelques secondes les quatre chefs de groupe sont à la hauteur de l’emplacement de l’adjudant, attentifs aux ordres qui vont suivre.
– Ouverture du feu sur mon ordre, vous gardez un œil sur moi au cas où le bruit de la bataille couvrirait ma voix. Pas de panique, parlez à vos hommes en permanence pour qu’ils sentent la présence d’un chef. Après l’assaut principal, je ne veux qu’un tireur sur deux en action. Economie de munitions et discipline de feu…C’est compris…Bonne chance mes petits.
Franz retrouve ses hommes en quelques enjambées rapides. Il transmet les ordres de l’adjudant, passe derrière chaque emplacement pour vérifier si le tireur est convenablement abrité par le petit muret de pierres et de sable. S’assure que chacun possède une bonne vision de l’espace de tir, répète les ordres d’ouverture de feu. Il est prêt pour son premier combat. La peur n’a pas encore fait son apparition. Tout est calme autour du bivouac.
Soudain la fusillade éclate. Les balles miaulent en passant par-dessus les têtes, soulèvent de petits geysers de sable autour des emplacements de combat. Franz remarque un de ses soldats avec du sang sur le visage.
– T’es blessé Maxime ?
– Non ! Pas grave caporal, ce sont des éclats de pierres qui m’ont sauté au nez.
Après quelques instants de tirs nourris, des cavaliers chargent en hurlant et en faisant des moulinets avec leurs armes avant de tirer. C’est fantastique, irréel, dans un décor qui ne l’est pas moins. L’attaque principale se fait devant la position de la première section ; chacun attend l’ordre de tir. Puis, une voix forte s’élève :
– Feu à volonté !
Les cavaliers sont à moins de cinquante pas de la position. Chevaux et cavaliers sont stoppés par un tir précis et jonchent le sol. Des cris, des hennissements de chevaux blessés, une poussière étouffante et agressive enveloppe la position. Le calme revient un instant. Puis, un deuxième assaut de cavaliers…
– Feu !
Cette fois, quelques cavaliers réussissent à sauter par-dessus le muret mais ils sont rapidement abattus par le groupe de commandement qui se trouve au milieu du dispositif. Franz encourage ses hommes, il fait le coup de feu comme un vétéran. Les assaillants se retirent en laissant de nombreux cadavres sur le terrain. Des chevaux sans cavalier errent ne sachant où aller, des hommes gémissent, blessés ; une odeur de sang chaud flotte dans l’air et le vrombissement des mouches produit un ronflement vibrant dans cette atmosphère chaude et poussiéreuse. L’ennemi s’est retiré. La voix de l’adjudant se fait entendre.
– Les chefs de groupe au rapport !
Rapidement, tous se retrouvent autour de lui.
– Je veux l’état des pertes et des blessés, munitions, eau. Vous avez deux minutes !
De retour sur sa position de combat, Franz jette un regard rapide sur ses hommes ; personne ne manque à l’appel, pas de blessé. Il fait le point des munitions restantes et de l’eau. Tout va bien. Il repart vers son chef de section pour faire son compte-rendu. Parmi les autres groupes, il y a un tué et deux blessés légers ; l’ennemi laisse une trentaine de cadavres sur le terrain. Franz s’aperçoit maintenant qu’une peur rétrospective le prend au ventre. Il pense bien s’isoler un moment mais c’est impossible, personne ne doit franchir les limites du campement.
Le calme est revenu, il semble que les rebelles abandonnent le terrain, mais comme dit l’adjudant « C’est une guerre de harcèlement, ils reviendront…ici ou ailleurs ». Petit à petit, Franz retrouve ses esprits ; l’excitation du combat, le danger, la mort, la peur, ont fait de lui un autre homme. Dans la fusillade, il a peut-être tué un homme. Des images assez vagues défilent devant ses yeux et il cherche à se persuader que l’homme qu’il a eu dans sa ligne de mire n’est que blessé, ses camarades l’ont sans doute évacué…Que c’est loin Sarreguemines, les jeunes filles de la faïencerie qui badigeonnent les planches de peinture…Franz regarde instinctivement ses mains comme pour y retrouver quelques traces, mais il ne voit que la poussière collée sur de la graisse d’armement.
– Vous restez en position ! Dit Franz à ses hommes. Un homme sur deux, nettoyage de l’arme, l’autre prêt à tirer. Maxime ! Va te faire soigner le nez, au retour tu passes chez l’adjudant et tu nous ramènes quelques munitions.
Une patrouille quitte le bivouac pour inspecter les alentours. La première journée de combat s’achève pour Franz. Pendant quatre mois encore, ils vont poursuivre les rebelles, les repoussant vers le sud du pays, vers les zones désertiques. Parfois des combats violents et brefs, toujours des morts et des blessés. Maintenant que les Aurès sont sécurisés, la poursuite continue à dos de cheval, vers le désert. De point d’eau en point d’eau, la lente progression s’arrête un soir de Noël dans une petite palmeraie près de Touggourt. Une chaude journée s’achève, hommes et chevaux sont épuisés. Fait exceptionnel, le capitaine commandant la compagnie rassemble l’ensemble des effectifs qui forme un carré autour du point d’eau. Il s’avance au milieu du dispositif parfaitement aligné. L’adjoint lui présente la compagnie dans le rituel réglementaire en usage dans les armées, puis, le capitaine s’adresse à ses hommes :
– Soldats ! Ce soir c’est Noël, nous sommes loin de nos familles, de notre pays…
Déjà, Franz n’entend plus l’officier ; il est loin, là-bas dans le froid de l’Est, la neige, l’arbre de Noël, la messe de minuit… Il entend des chants qui viennent du plus profond de ses souvenirs, mélopées de son enfance qui reviennent avec douceur lui rappeler ses jeunes années. A cette époque de fêtes, sa mère est sans doute en train de faire des petits gâteaux secs, striés et sans forme précise mais tellement bons. Ses petites sœurs attendent avec impatience une nouvelle poupée, un landau ou un objet pour compléter leur ménagère. Le père, très fier de pouvoir offrir à ses enfants quelques cadeaux, menace de fermer les volets et la porte à clé si les filles ne sont pas sages, le Père Noël en trouvant la porte close, passera son chemin. Et les filles, pour faire plaisir à leur père vont simuler une frayeur immense en faisant semblant de croire encore à ce merveilleux conte de Noël.
Le bivouac s’installe pour une nouvelle nuit. Les sentinelles sont déjà en place et le ciel prend une couleur fuchsia avant la disparition du soleil sur le lointain horizon de dunes. Les premières étoiles apparaissent, d’autres suivent et bientôt une multitude de diamants scintillent dans la nuit. Les nuits du désert offrent un spectacle extraordinaire. Il est peu d’endroits au monde où cette vision est possible avec une telle intensité. Dans le bivouac, seules les réponses des sentinelles aux appels du gradé de garde parviennent parfois à rompre le silence total qui a tout envahi. Comme une horloge humaine, les questions et les réponses ponctuent le temps ; « Tout va bien ? », « Tout va bien sergent ! ».
Une petite fraîcheur matinale réveille Franz ; sous la toile qu’il a mise sur le sable pour dormir, de petits bruits inquiétants mettent ses sens en éveil. Surpris, il se lève rapidement, craignant le pire, un animal est en train de l’attaquer. Enorme rire de ses camarades, ce sont en fait de petits coléoptères, des bousiers qui poussent inlassablement des boules de terre devant eux provoquant ainsi ce bruit de frottement qui a inquiété le caporal, chef d’un groupe de combat. Une petite rougeur apparaît sur ses joues, vexé d’avoir été surpris par un animal gros comme la moitié d’un pouce. Une nouvelle journée dans le désert s’annonce par l’apparition d’un énorme soleil rouge qui surgit au-delà des dunes.
Ce jour-là, la première section est en tête du dispositif pour les reconnaissances des abords immédiats de l’axe de marche de la colonne principale. Vers le milieu de la matinée, la chaleur se fait déjà bien sentir et un petit vent chaud sèche la peau et hâle les visages ; la progression devient plus lente. Le groupe du caporal Franz franchit en tête une rangée de dunes qui dévale en pente douce vers une petite oasis avec une vingtaine de palmiers et sans aucun doute un point d’eau. Soudain, des coups de fusils. Franz tombe à terre, percuté par un grand coup de bélier, le souffle coupé. Il s’évanouit.
Quand il ouvre enfin les yeux et que ses sens reviennent, il sent une très grande douleur à l’épaule droite. Il ne peut plus bouger son bras et respire difficilement. Un infirmier est penché sur lui et lui nettoie le visage. Franz voudrait parler, mais aucun son ne sort de sa bouche, à chaque respiration, une douleur vive lui arrache les poumons. L’infirmier tente de le calmer et de le rassurer.
– T’as eu un bon coup dans l’épaule…La clavicule est brisée, mais la balle est ressortie sans trop de dégâts. Respire doucement et ne t’énerve pas, le toubib pense que le poumon n’est pas touché, un gros trou et une fracture, tu t’en tires bien.
Epuisé par cet effort, il retombe dans un semi-coma et tout devient flou autour de lui. Les voix sont lointaines, les formes diffuses, il croit parfois reconnaître la voix d’une de ces têtes énormes qui se penchent sur lui et qu’il voit comme à travers une loupe. Il ne pense à rien, seule sa douleur est présente. Pendant plusieurs jours, allongé au fond d’un chariot, il ressent les chaos de la piste, le râle des autres blessés qui l’accompagne dans sa souffrance arrive à ses tympans comme un chant triste qui veut dire à la Grande Faucheuse qu’ils sont toujours en vie et qu’elle arrive trop tôt.
Pendant l’éternité de ces six jours de piste, au fond de ce chariot, les moments de lucidité et d’inconscience se succèdent. La soif, parfois la faim, mais toujours cette atroce douleur qui le tenaille sans répit, l’oblige à lutter encore et encore. Ses forces diminuent mais il s’accroche, il sait qu’au bout de cette piste il y a le salut, l’hôpital, le chirurgien, la guérison même. Il veut vivre.
Hôpital militaire d’Alger, 2 janvier 1872.
J’ai sauté une année sans m’en apercevoir. L’opération de mon épaule est une réussite d’après le chirurgien. Je retrouverai l’usage de mon bras. J’ai, d’après l’infirmière, un gros trou dans le dos du fait de la chair manquante. La douleur est moins intense et j’ai très faim. Le médecin dit que c’est bon signe et que mon corps réagit.
Franz a eu beaucoup de chance, aucun organe vital n’a été touché et malgré l’état de choc dû à sa blessure, son physique robuste et sa jeunesse reprennent le dessus rapidement. Cela fait maintenant quinze jours qu’il est dans cet hôpital, l’infirmière qui a fait les soins ce matin, lui a apporté une bonne nouvelle ; il va pouvoir se lever et faire une heure de promenade dans les jardins. Les premiers pas ont été difficiles, la tête lui tournait et l’aide de l’infirmière est indispensable pour ne pas tomber. Rassurante, la petite soignante lui a expliqué que cela est normal et que demain tout rentrera dans l’ordre.
Quelques jours plus tard, Franz est dans le parc, à l’ombre d’immenses palmiers, il reçoit une visite surprise ; l’adjudant et deux de ses hommes arrivent les bras chargés de fruits et de dattes sucrées.
– Alors mon petit, comment vas-tu ?
Franz, surpris et heureux à la fois de retrouver ses compagnons, ne sait pas trop quoi répondre.
– Ca va, ça va !
– Et les infirmières ; elles vont bien ? Reprend l’un des deux soldats.
Et les quatre hommes se mettent à rire, un rire nerveux et bruyant, heureux de se retrouver en vie après les combats, les longues semaines sur les pistes et le sable brûlant du désert. Fraternité d’arme sans doute, mais sincère. Quelque chose de fort lie ces hommes d’une façon durable, chose qu’ils expriment avec des mots simples, un regard parfois où l’on devine au fond des yeux, la souffrance.
– Après ta blessure, nous avons continué notre progression vers le sud. Du côté d’Ouargla, il y a eu un gros combat avec les derniers fidèles de Bou Mezrag mais il a réussi à s’enfuir. C’était le 14 janvier dernier ; des hommes lancés à sa poursuite l’on retrouvé mort près d’une petite flaque d’eau six jours plus tard. La révolte est terminée…Jusqu’à la suivante.
– …
– Mais j’ai autre chose pour toi ; quatre mois de solde, cela fait de toi un soldat fortuné mon petit ! Tiens ! Signe ce registre sinon ils vont croire que nous avons fait la fête au souk.
Pendant plus d’une heure encore, les quatre hommes se racontent des histoires, du retour à Sidi-Ferruch, des folles soirées avec les mauresques qui chauffaient les nuits avec leurs danses du ventre où la chair remuante va au rythme d’une musique aux accents des mille et une nuits. Les moments de silence sont désormais de plus en plus longs, ils ont vidé la dernière peur coincée au fond de leur âme en se parlant ; ils vont bien et la vie peut reprendre son cours.
– On va partir, il ne faut pas rater le convoi de ravitaillement. A bientôt petit !
– Merci mon adjudant !
Chacun serre vigoureusement la main du convalescent avec un « A bientôt ! » encourageant. Dans leur aspect rude, ce sont des hommes ordinaires avec leurs excès parfois, mais aussi leurs émotions sincères et profondes où l’amitié a une place importante. Ils s’en vont, se retournent une dernière fois au bout de l’allée pour faire un signe de la main et disparaissent.
La jeune Emma vient lui rappeler qu’il est l’heure des soins, très maternelle, elle le gronde comme on gronde un enfant en faute. Franz s’appuie sur elle pour marcher alors qu’il peut très bien se déplacer tout seul. Mais il éprouve le besoin de poser son bras valide autour des frêles épaules de la jeune fille. La chaleur et la douceur de sa peau sont une caresse pour sa main lourde et rêche, son émoi est un signe de sa guérison prochaine.
Cela fait cinq semaines qu’il est dans cet hôpital, la petite Emma s’approche de lui avec un grand sourire et un courrier à la main. Elle fait deux fois le tour de Franz en sautillant le bras en l’air. Il tente de l’attraper mais elle esquive son geste avec souplesse et grâce, depuis quelque temps il y a une grande complicité entre eux.
– Une lettre de Sarreguemines ! Dit-elle. C’est une écriture de fille.
– Emma s’il-te-plaît !
Avec une petite moue, elle cède le courrier à Franz qui détruit sans ménagement l’enveloppe de cette lettre tant attendue. Il tourne le papier dans tous les sens pour trouver le début du texte. Enfin ! Il lit…
– C’est ma petite sœur…Ils vont bien…Ma blessure les inquiète beaucoup…
La brave petite Emma s’éclipse discrètement laissant Franz s’évader vers son pays et sa famille. Elle sait que la guérison de Franz est proche et qu’il va bientôt disparaître de sa vie, mais elle aime bien ce grand gaillard blond.
Quelques jours plus tard, le Médecin-chef de l’hôpital le convoque dans son cabinet. Avec lui, deux autres personnes ; le chirurgien qui l’a opéré et un médecin militaire. Après les questions habituelles sur son état général, ils auscultent Franz, forçant sur son bras blessé pour se rendre à l’évidence ; il n’a récupéré que cinquante pour cent de sa mobilité. Une sentence, sèche, brutale, va tomber.
– Le chirurgien a limité les dégâts, car la blessure était vilaine et vous avez eu beaucoup de chance. Malheureusement, c’est un cas de réforme et nous en sommes désolés. Par contre, vous allez bénéficier d’une pension et d’une priorité pour vous installer comme colon. Vous serez démobilisé par les services du Bureau de Garnison d’Alger où vous vous présenterez demain matin. Bonne chance !
C’est un coup de massue qui tombe sur le crâne de Franz. Sa courte carrière de soldat s’achève dans ce bureau, il faut qu’il repense sa vie, son avenir. Une chose est certaine dans son esprit ; il veut rester en Algérie.
Alger, 4 février 1872.
Je suis civil depuis une heure. Le Bureau de Garnison m’a remis un dossier de pension et mon ordre de démobilisation. Avec les quatre mois de solde et ma pension, j’ai de quoi subvenir à mes besoins pour les six mois à venir. Je n’ai pas de vêtements civils et je ne sais pas où dormir cette nuit. Demain je dois me présenter dans les bureaux de l’administration coloniale pour qu’il m’affecte une concession.
Franz se dirige vers le centre d’Alger en quête d’un hôtel et de magasins pour trouver de quoi se transformer en « pékin ». Il a toute la journée devant lui, il se fait déjà une raison à sa nouvelle situation. Place du Gouvernement, hôtel Apollon, cela lui convient parfaitement. Le voici au centre d’un dispositif commerçant très animé. Il va errer pendant des heures et croiser une foule de gens dont il découvre la diversité d’origine et de langage. Italiens, Maltais, Espagnols, Juifs mais aussi ceux qui depuis la nuit des temps peuplent cette partie du monde, les Mzabites venus du désert, les Maures anciens bourgeois de la vieille Al-Djazä’ir devenue Alger désormais. Partout des nègres qui sont de tous les métiers difficiles, aujourd’hui casseurs de pierres dans cette ville en pleins travaux demain portefaix mais toujours de bonne humeur avec un sourire perpétuel, étalant leurs grosses lèvres pour laisser apparaître des dents d’une blancheur éclatante.
Rue après rue, Franz découvre une ville en construction, d’énormes bâtisses surgissent du sol à côté de petite construction d’un autre âge. Dans les vieilles ruelles, d’innombrables petites échoppes où l’anisette d’Espagne et l’absinthe frelatée procurent l’ivresse à bon marché. Les propriétaires de ces lieux sont des Maltais, une large ceinture autour du ventre, les manches retroussées font apparaître des bras musclés et velus. Une tête avec une épaisse chevelure noire et bouclée, cerclée d’un collier de barbe qui fait le tour d’un visage presque cruel, de gros poils sortent des oreilles pour cacher des boucles en or. Leur sourire est aussi inquiétant que leur aspect sauvage de pirate.
Une grande rue comme on peut en voir dans les villes de France avec des enseignes multicolores, des éclairages, des vitrines. C’est là que Franz va trouver les vêtements nécessaires à sa métamorphose. Un homme se doit de posséder un couvre-chef, il opte pour une casquette. Ensuite, un pantalon noir à rayures grises, une chemise avec un petit gilet, les chaussures militaires particulièrement solides feront l’affaire pour le moment. Ah ! Une paire de bretelles, impératif pour avoir un pantalon bien droit. Après réflexion, une deuxième chemise, pour le change bien sûr. Une veste, légère, bien coupée, d’une couleur claire, beige par exemple…L’après-midi se passe ainsi à acheter, discuter le prix, vu l’ampleur des achats, le commerçant juif consent à une remise et lui offre un ruban-cravate en prime. Franz est satisfait de ses achats qu’il va déposer dans la chambre de son hôtel.
Le lendemain matin, il décide de se présenter, à l’administration des Domaines, en tenue militaire ; il pense que cela fait plus sérieux. Il y a déjà beaucoup de monde, des familles avec deux, trois voire cinq enfants attendent que l’huissier hurle leur patronyme dans le vacarme que font les enfants en jouant et que les parents ne maîtrisent plus. Après deux heures d’attente Franz est enfin admis dans le bureau des « sésames ».
– Monsieur ! Vu vos états de service, vous êtes en droit de choisir une administration ou une concession agricole. Votre présence ici semble indiquer que votre choix est fait.
Franz découvre qu’il a fait « un choix » car personne ne lui a indiqué qu’il avait la possibilité de rentrer dans une administration. Soit ! Il deviendra paysan.
– Nous vous cédons une concession de cinq hectares dans l’Oranais, à Tiaret, une nouvelle commune que nous venons de créer. C’est un poste militaire qui a pris de l’ampleur. Vous y trouverez un terrain en friche que vous devrez mettre en valeur comme cela est stipulé dans votre contrat. Dans un premier temps, vous vous présenterez au dépôt d’Oran où l’on vous remettra, gracieusement, une charrue, un sac de semences, un fusil et vingt francs qui vous permettront de démarrer dans votre nouvelle vie. Je vous demande de signer ici…et ici. Merci ! La cession des terres gratuites est, en principe, arrêtée depuis l’an dernier ; mais votre cas est particulier. Bonne chance monsieur !
Le lendemain, il décide de partir pour Sidi-Ferruch, récupérer quelques affaires et particulièrement ses couverts qu’il avait achetés avec son ami Auguste. Il doit faire ses adieux à l’adjudant et lui raconter cette nouvelle aventure.
Les adieux à ses camarades de Sidi-Ferruch ont laissé une trace profonde, et pendant les cinq jours de diligence qui vont le mener vers Oran, son esprit a beaucoup de mal à se détacher de sa courte vie de soldat. Le moment était fort en émotion, il ne songe même pas à son avenir ; il est là-bas en Kabylie, dans le désert…avec ses camarades de combats. La route côtière est belle pourtant, mais Franz ne voit rien de ces beaux paysages.
Enfin, Oran !
Oran, 12 février 1872.
J’ai plus de bagages qu’à mon départ de Sarreguemines et j’ai la sensation d’être plus riche. Il me faut l’aide d’un muletier pour le transport vers un hôtel.
Oran (en arabe Wahran), comme Alger, est en plein essor. Des travaux de construction, des quartiers nouveaux surgissent de terre et transforment la ville. Pourtant, Oran est une vieille ville créée par les Maures venus d’Andalousie au début du X° siècle. Après leur départ, vers la fin du XV° siècle, le port est devenu un repaire de pirates. Les Turcs, puis les Espagnols, au XVIII°, se succèdent. Les premiers construiront la grande mosquée, les seconds y édifièrent la grande citadelle de Santa Cruz. Malgré le tremblement de terre de 1790, la Casbah a retrouvé son aspect d’antan et la vie, presque secrète, des petites ruelles a repris son cours. C’est dans ce décor que Franz découvre la ville.
– Bonjour monsieur ! Je m’appelle Franz Reinhardt et j’ai obtenu une concession. A qui faut-il que je m’adresse ?
– C’est au premier étage, bureau des Domaines, faites-vous inscrire au secrétariat.
– Merci monsieur !
Depuis quarante huit heures qu’il est dans cette ville d’Oran, Franz n’a fait que dormir et manger. Le voici d’attaque pour affronter l’administration et ses méandres pour obtenir ce bout de terre d’Afrique qu’il ambitionne. Conscient que ce nouveau métier n’est pas facile, il a néanmoins longuement réfléchi à ce problème et il se sent capable d’engager le combat contre la terre et lui-même. Son ignorance va lui causer, sans aucun doute, quelques déboires, mais il est fermement décidé à s’accrocher à cette nouvelle vie qui s’offre à lui.
– C’est à vous…Entrez !
– Merci ! …
En entrant dans cette pièce, trop grande pour le peu de meubles qui l’occupent, un sentiment étrange l’envahit. Franz se sent ridiculement petit sous ce plafond aux décors de plâtre parfaitement blanc qui se trouve à deux hauteurs d’hommes au-dessus de sa tête. Les murs semblent lointains, la taille des fenêtres et des portes dans leurs chambranles sculptés peut laisser passer un cavalier avec sa monture. La sévérité de l’endroit est un peu atténuée par la présence de chérubins qui, entre murs et plafond, semblent voler au secours du visiteur. Un chemin de tapis étouffe le bruit des pas et mène vers un bureau aux dimensions gigantesques, un petit homme est assis là, pâle, sans expression, de petites lunettes pincées sur son nez ; il consulte un des dossiers qui s’empilent sur un coin du bureau. D’un geste de la main il répond aux salutations du visiteur et l’invite à s’asseoir sur un fauteuil au dossier très haut recouvert d’un tissu feutré rouge. La voix qui sort du corps de ce petit homme est étonnamment forte et fait sursauter Franz. Les mots résonnent dans la pièce.
– Vous n’êtes pas marié ?
– Non monsieur ! Mais c’est un projet pour plus tard…
– Seul, vous aurez beaucoup de problèmes à résoudre, il vous faut trouver une femme qui vous donne des enfants rapidement. En règle générale, les concessions ne sont accordées qu’aux mariés, votre cas est différent, néanmoins, je me permets de vous conseiller de trouver une épouse, c’est une aide précieuse. Vous irez donc à l’adresse indiquée sur ce document, nos services vous fourniront le matériel auquel vous avez droit, dès votre arrivée à Tiaret vous vous présenterez à la mairie pour enregistrer votre concession. Je vais vous remettre une somme d’argent qui vous permettra de vivre quelque temps.
Les formalités achevées, Franz, qui a beaucoup réfléchi durant ces deux derniers jours, décide de se rendre sur le marché. Son plan ; il veut se rendre compte visuellement des produits de consommation courante qui sont sur les étals. Se renseigner, se documenter, étudier la possibilité de vivre correctement du produit de son labeur. Il veut savoir.
Oran, 15 février 1872.
Départ vers Tiaret pour l’enregistrement de ma concession. Je m’occuperai de la perception de mon matériel à mon retour.
Depuis peu, un service de diligence emprunte les toutes nouvelles routes à l’intérieur du pays. Des travaux gigantesques qui permettent désormais de relier Constantine, Alger et Oran par les bourgades créées pour les colons. La production des fermiers s’écoule par ces nouvelles voies vers les grands centres et approvisionne les marchés toute l’année. L’ancienne route côtière est devenue un axe secondaire que seuls les habitants des villages côtiers empruntent encore. Pour rejoindre Tiaret, il faut faire une halte à Relizane pour la nuit, dans un relais de poste où voyageurs et chevaux se restaurent et se reposent avant de continuer le lendemain, vers Tiaret, gros bourg à une journée de diligence.
Dans un grand nuage de poussière, le coche s‘arrête sur la place, au pied de la redoute militaire. Les chevaux hennissent, soufflent et piaffent nerveusement après l’effort qu’ils viennent de fournir. Des enfants accourent, curieux de voir les voyageurs et proposent leurs services pour porter les bagages. Le relais est à quelques pas, la mairie juste en face, de l’autre côté de la place. Mais il est trop tard pour les formalités que Franz doit effectuer pour l’enregistrement de sa concession, la fin de la journée est proche. Il décide de rester, pour la nuit, au relais de poste. L’aubergiste et sa femme gèrent l’ensemble ; auberge, relais, chevaux et étables. Ils vont et viennent pour s’enquérir auprès des clients que rien ne manque, et que tout va bien. Dans la cuisine que l’on aperçoit au fond d’une grande salle à manger, une vieille mauresque s’affaire autour d’une cuisinière à plusieurs foyers. Sur une table, des légumes multicolores et de la viande en morceaux attendent le moment de la cuisson. Un jeune garçon muni d’un chasse-mouches, surveille le futur repas en mâchonnant des dattes qu’il puise d’une main au fond d’un plat, l’autre servant à chasser les mouches d’un geste souple et négligent. L’aubergiste, homme corpulent mais pas très grand, s’agite comme un beau diable pour tenter d’accélérer la préparation de la salle à manger, mais les deux jeunes maures, chargés de cette tâche, ne semblent pas vouloir se presser d’avantage. Son épouse, tout aussi corpulente, sert de l’eau fraîche aux voyageurs et échange des banalités avec les femmes et les enfants.
Le repas, un couscous, a été très apprécié après la longue étape de la journée. Une petite fraîcheur s’installe maintenant que le soleil a disparu. Les femmes s’éclipsent avec les enfants et les hommes sortent pour faire quelques pas sur la place et discuter un moment. Franz se joint à eux. L’un des hommes s’adresse à lui. Vêtu comme un ministre avec un chapeau à large bord, de petite taille, il se tient très droit, porte moustache et barbichette à la Napoléon III.
– Votre voyage s’achève ici, je crois ! J’ai cru comprendre que vous avez une concession à Tiaret.
– C’est exact, monsieur ! En fait, je viens pour l’enregistrer.
– Un nouveau colon en somme ! Je vous souhaite bien du courage ; les trois premières années ont été très difficiles pour nous. C’était avant que les autorités ne construisent les villages de colons. Il nous a fallu construire nous même un abri tout en défrichant la terre. Les premières récoltes ont été les légumes de notre potager. Un peu de chasse pour la viande, c’est ainsi que nous avons survécu ces trois années terribles. Puis, nous avons, mon frère et moi, diversifié nos cultures afin de nous rendre compte de ce qui était le plus propice et le plus rentable. Dix ans après, nous sommes sortis d’affaire. J’ai une belle demeure, dattes, olives et moutons ont été les éléments de notre réussite. Il faut dire aussi, pour être honnête, que mes voisins ont abandonné au fil des ans et j’ai racheté leur exploitation en y installant un métayer. « Chassard frères », la plus grosse exploitation de la région.
– Bravo monsieur ! Reprend un autre homme aussi rondouillard que le premier. Le bon sens et la ténacité, c’est le secret de la réussite. Ne pas confondre avec l’entêtement ; il s’agit en fait d’avoir le courage de changer d’orientation si cela est nécessaire.
Intervient le troisième voyageur. La quarantaine, fin et de la taille de Franz. Il a l’air moins aisé que les deux premiers ; son pantalon, trop court, laisse apparaître le haut de ses bottines et sa veste a souffert du temps. Une fine moustache barre un visage au regard franc.
– Je suis heureux de constater que vous êtes Français ! Dans la région d’Oran, les Espagnols sont en masse et profitent de leur nombre pour s’imposer dans les mairies et dans l’administration. Même les textes officiels sont rédigés en espagnol, nous sommes en terre française que diable !
Franz ne relève pas le propos. Il se rappelle que dans son pays les documents officiels sont en français et en allemand…
– Vous venez de quelle région ? Reprend monsieur Chassard.
– Je suis Lorrain, mon nom est Franz ; Franz Rheinhardt !
– C’est la guerre sans doute qui vous a chassé…Dans la région d’Alger, il y a beaucoup de Lorrains et d’Alsaciens.
– Le troisième homme reprend la parole. Mon nom est Paul Blanchard, je suis de Mascara où j’ai une exploitation d’arbres fruitiers. Je suis également le représentant régional du Comité d’action républicain aux colonies auquel je vous recommande d’adhérer. Notre soutient et nos conseils pourront vous être d’une grande utilité. Voici ma carte.
– Merci monsieur ! J’y songerai.
La fraîcheur bienfaitrice du soir anime la place, où de petits groupes s’agitent dans des discussions vives. Assis à même le sol ou sur de petits bancs, les indigènes sirotent un verre de thé que les femmes versent régulièrement avec un geste ample sans qu’une goutte de liquide ne se perde. Le groupe de promeneurs revient vers l’auberge-relais se souhaitant une bonne nuit et se sépare. Franz reste encore un moment et pense à ce qu’il vient d’entendre.
Le lendemain matin, lorsqu’il pénètre dans la salle à manger, il aperçoit la vieille mauresque, toujours devant ses fourneaux, fidèle au poste. Une odeur de café chaud flotte dans l’air. La maîtresse de maison surgit d’une pièce voisine avec un grand sourire et salue son jeune client.
– Bien le bonjour monsieur ! Avez-vous bien dormi ?
– Bonjour madame ! Très bien, merci !
– Je vous fais servir un café…Ahmed ! Le café pour monsieur…Fissa, fissa !
Le petit déjeuner, avec le café, se compose de fruits et de galettes. L’odeur du lait de chèvre chaud domine, mais Franz y est habitué maintenant. Depuis son arrivée en Algérie, il a goûté aux plats du pays sans retenue et, outre les merveilleuses pâtisseries, makroudhs, mantecaos, dattes farcies, les plats cuisinés sont un délice pour le palais. Dans les cafés près du port d’Alger, il déguste volontiers des anchois frais, trempés dans des œufs battus puis de la chapelure et ensuite plongés dans de l’huile très chaude. Le tout saupoudré de coriandre fraîche ciselée, un véritable plaisir. Mais ses plats favoris restent la soupe de fèves où, oignons ail et tomates se mélangent subtilement avec la coriandre, le piment, le sel et le poivre. Puis les boundigas, boulettes de viande de bœuf et de pommes de terre râpées, malaxées avec des épices. L’ensemble cuit dans un bouillon de volaille un petit quart d’heure avant d’être égoutté. Des œufs battus en omelette, avec une goutte de vinaigre sont versés dans le bouillon de volaille ce qui provoque une cuisson en filaments de l’omelette. Les boulettes sont ensuite mélangées à cette sauce. Les boundigas lui rappellent les boulettes de viandes que confectionne sa mère, les épices en moins. Dieu, que c’est bon !
– Je dois me rendre à la mairie ; pouvez-vous m’indiquer les horaires d’ouverture ?
– Le secrétaire de mairie ne va pas tarder ; il vient chaque matin boire un café à l’auberge avant de prendre son service. En partant avec lui, vous serez le premier « client ».
La journée se présente bien. La mairie est à deux pas, sans attente pénible dans des salles surpeuplées, chauffées par le soleil et la présence des administrés en sueur qui restent stoïquement sur les bancs pour ne pas perdre leur place.
Ses compagnons de voyage arrivent avec femmes et enfants pour prendre leur collation matinale. Chacun se salue avec courtoisie et s’installe pour ce rituel qui démarre une bonne journée. Enfin, le secrétaire de mairie fait son apparition. La maîtresse de maison s’empresse de présenter son client au notable, ce qui facilite la tâche de Franz. Monsieur Pierre porte chapeau melon, veste noire, pantalon gris rayé et une paire de chaussures montantes. Sous le col cassé de sa chemise, une cravate ruban soigneusement nouée, un gilet boutonné, assorti à son pantalon, est traversé par une chaînette qui se termine sans doute sur une montre à gousset. L’homme a environ trente cinq ans, de grande taille et maigre, son visage aux joues creuses est rehaussé d’une épaisse moustache et d’une paire de rouflaquettes qui descendent à l’extrême limite de la mâchoire inférieure.
– Bienvenue à Tiaret cher monsieur ! Nous allons nous occuper de votre cas sans tarder.
Et pendant que la discussion s’engage entre les deux hommes, le brave Ahmed apporte deux bols de café fumant. La journée se présente vraiment bien pour Franz. Un moment plus tard, Franz se retrouve dans le bureau du secrétaire de mairie. La pièce est grande et sommairement meublée. Au fond du bureau, près d’une grande fenêtre, un meuble à tiroirs aussi larges que le meuble. Monsieur Pierre ouvre un de ces tiroirs et en sort une carte qu’il étale sur le dessus du bureau. C’est un plan du cadastre.
– Approchez, monsieur Rheinhardt ! Je vous montre votre concession…C’est celle-ci, près de l’oued Mina. Remarquablement située. Il y a toujours de l’eau, même pendant les années de sécheresse de 67, 68, 69, le puits n’était pas à sec. Elle avait été attribuée à un couple d’espagnols, mais la jeune femme est morte en couches et l’homme, resté seul avec deux enfants, est mort du choléra lors de l’épidémie de 67, quelques jours après l’un de ses fils. L’autre petit a été envoyé chez les religieuses à Oran. Un de nos gardes va vous guider vers les lieux. Mais terminons d’abord les formalités.
Une petite heure plus tard, l’enregistrement terminé, Franz tout heureux, retourne à l’auberge où il a convenu d’attendre le garde. Il note dans son journal…
Tiaret, 17 février 1872.
Il est neuf heures trente. Ma concession est enregistrée à la mairie.
Une heure s’écoule avant que le garde n’arrive avec un cabriolet que tire un magnifique cheval isabelle.
– Salâm’alaykoum ! Je m’appelle Chachoua et je dois vous guider jusqu’à votre propriété.
– Salâm’ ! Merci ! Je suis impatient de voir mon futur domaine.
L’attelage et les deux hommes quittent le village pour emprunter une piste mal entretenue et au bout de vingt minutes, Chachoua s’arrête au sommet d’un petit mouvement de terrain et en tendant le bras, il dit à Franz…
– C’est là monsieur !
Le nouveau propriétaire a un choc. L’endroit est désertique. Au moment de la création, la terre devait ressembler à cela. Une piste en mauvais état descend vers un oued où coule une eau couleur sable. Un peu à l’écart sur une bosse du terrain, deux cyprès malades jettent une ombre squelettique sur une maisonnette. Envahie par les chardons et les herbes, la terre est à l’abandon. La maison n’est pas très grande avec ses deux pièces carrées. La première, en entrant, est à la fois cuisine et salle à manger. De lourdes jarres de grès sont posées à même le sol, une cuisinière moderne trône dans un coin. Une porte donne accès à l’autre pièce, la chambre à coucher. A l’extérieur, un hangar est adossé à la maison avec deux grands battants, il peut servir d’écurie et de remise pour le petit matériel. L’ancien propriétaire a creusé un puits d’une vingtaine de coudées de profondeur. L’eau est claire et semble potable. Il faudra changer quelques vitres brisées et remplacer les volets qui ont disparu. Le toit laisse passer par endroit, les rayons chauds du soleil, mais l’ensemble n’est pas catastrophique. Avec un peu de courage et de savoir-faire, en quelques jours cette demeure peut redevenir habitable. Franz se rend compte que malgré tout, la chance lui sourit. Avoir une maison dans ces conditions, c’est inespéré. Il va pouvoir s’installer avant les grandes chaleurs et défricher une partie de son terrain pour en faire un potager. Le pays fournit l’eau, le soleil ; Franz a la volonté et l’énergie indispensable à la réussite de son projet.
Chachoua montre les limites du terrain, il semble connaître chaque caillou, chaque buisson. A l’endroit qu’il lui désigne, Franz fait un bornage sommaire en empilant des pierres. Il décide de revenir le lendemain pour faire un inventaire du matériel nécessaire pour les travaux et prendre quelques mesures. De toute façon, la prochaine diligence ne passe que le surlendemain. De retour à l’auberge, il engage une longue conversation avec l’aubergiste pour se documenter sur le village, ses habitants, ses voisins. Il apprend ainsi que ses voisins de parcelle sont des espagnols ; un couple installé depuis près de vingt ans qui possède une trentaine d’hectares dont la moitié à peine est exploitée. Les céréales leurs procurent des revenus suffisant pour survivre. Ils ont cinq enfants, cinq filles, au grand désespoir du père qui espérait des bras d’hommes pour le travail de la ferme. Les deux plus grandes sont mariées, la plus jeune n’a qu’une dizaine années. Depuis que le calme et la sécurité sont revenus, des lignes régulières desservent l’arrière pays, les personnes, le courrier et les marchandises, circulent avec une ponctualité quasi militaire. Le repas de midi est vite avalé. Nerveux, excité, Franz tente de se calmer en pratiquant un exercice local très prisé ; la sieste. Il ne dort pas, mais, derrière ses paupières closes, des images défilent…
Il voit le chemin d’accès à la ferme planté, de part et d’autre, de cyprès ; une quarantaine sans doute. L’eau, qui semble être en permanence dans l’oued permet l’arrosage d’arbres fruitiers ; orangers et citronniers. Ces fruits se transportent facilement et restent frais suffisamment longtemps pour les écouler dans de bonnes conditions sur les marchés des grandes villes. En attendant que les arbres fruitiers arrivent à produire, il fera du blé comme ses voisins. Le potager produit des légumes pratiquement toute l’année ; il a noté l’expérience de monsieur Chassard. Il faut planter des cyprès pour couper le vent qui emporte les fleurs des fruitiers. Les fleurs des orangers et des citronniers que butinent des centaines d’abeilles, produisent un miel parfumé très apprécié. Un revenu non négligeable, comme l’excédant des légumes du potager d’ailleurs. Depuis qu’il voyage à travers le pays, en civil, Franz a une autre vision de l’Algérie. Il découvre une réalité, bien différente des discours officiels. Mais en écoutant et en observant, il a beaucoup appris. Il sait que les premières années vont être difficiles. Il sait aussi qu’il est seul, très seul. Mais il ne veut pas embarquer une femme dans cette galère, des enfants qu’il doit nourrir, une responsabilité supplémentaire.
L’après-midi s’achève ; Franz décide de faire connaissance avec sa nouvelle ville. Il s’en va donc au hasard des rues. Tiaret, avec son millier d’habitants, est un gros bourg en pleine transformation. Une brume couleur sable, très sèche, flotte dans les ruelles, c’est le sirocco. L’air est difficilement respirable. En traversant le quartier juif aux ruelles tordues, ils sont là, en groupe, assis à même le sol, à discuter d’affaires en arabe avec des accents yiddish. Les voyelles grincent et les consonnes craquent dans des mots lancés dans le vent comme un chant d’un ton aigu. Des gestes de tête et d’innombrables gestes des mains, ponctuent les longs monologues des juifs bavards. Au milieu des ruelles, des enfants se coursent, piaillent, les plus petits, ventre et fesses à l’air, dorment sur les immenses jupes multicolores des matrones aux poitrines énormes et molles. Sur chacune d’elles, scintillent des boucles d’oreilles, des colliers, des bracelets, dix par bras au-moins. Les odeurs de sueurs se mêlent à l’odeur des oignons grillés. Puis, subitement, le calme digne des quartiers arabes, un changement brutal. Des hommes en burnous blancs causent à mi-voix derrière des étalages de fruits et de légumes et mille choses colorées. Au coin d’une autre ruelle, un café maure, là aussi, que des hommes ; ni femmes, ni marmaille ne troublent la quiétude de ces lieux uniquement masculins. Un peu plus loin, le village nègre, amas de pierres et de branchages sommairement reliés. C’est là que vivent ces gens venus du désert. Puis, la grande place avec quelques tourbillons de poussière. C’est le soir, un soir de sirocco dans sa nouvelle ville. Franz vient de s’apercevoir qu’en fait, il a tourné autour de la « Redoute » qui est le centre de cette nouvelle commune. En pénétrant à l’intérieur de la redoute militaire, il se rend rapidement compte des mauvaises conditions de vie dans le quartier des « colons » où beaucoup sont venus se réfugier depuis l’insurrection des Ouled Sidi Cheick puis des calamités des années 1866/67/68. Entre le choléra, les sauterelles et les années de sécheresses, les premiers colons de Tiaret ont subi des épreuves terribles. A la sortie sud de la redoute, Franz découvre un magnifique paysage. Un immense plateau qui s’étend à l’infini où seule une montagne carrée accroche le regard. Là-bas, au lointain, une chaîne de montagnes émerge comme une île sur l’horizon d’un océan. Le Raz Fortaz culmine à plus de 1500 mètres. C’est dans ce massif de l’Oudjila, à Taguine, que l’Emir Abd el-Kader s’était caché après la prise de sa smala. Tiaret s’étend ainsi sur les pentes du Djebel Guezoul à une altitude de près de 1100 mètres et le climat est sain et agréable dit-on. Si le Sirocco brûlant étouffe les jours d’été, la neige, en hiver, recouvre Tiaret d’un épais manteau blanc. L’aubergiste qui lui a raconté tout cela, lui a même signalé que les cigognes appréciaient cette région et que cela lui rappellera sans doute son lointain pays.
La journée suivante est consacrée à l’inventaire des matériaux nécessaires aux réparations, pour rendre cette maison habitable. Il inscrit dans son carnet, à la suite de son journal, les mesures des vitres, la longueur des planches pour les volets, le nombre de tuiles pour la réfection de la toiture etc… Au bout d’un moment, il réalise que le transport de tout ce matériel, représente le volume d’une charrette…et donc d’un cheval. De toute manière, dans son esprit, cette dépense, indispensable, est prévue de longue date. Il a mis suffisamment d’argent de côté pour les premiers achats et pour vivre la première année. Il lui faut un coup de pouce que le banquier a promis de lui accorder. Lors de son cours séjour à Oran, de peur de perdre la grosse somme d’argent en sa possession, il a eu la bonne idée de lui confier sa petite fortune, et veut mettre à profit les aides financières qui pleuvent sur ceux qui tentent l’aventure, sans état d’âme et sans complexe. Ceux qui sont devenus rapidement très riches ne doivent pas leur réussite à la sueur de leur front, mais à des combines que la loi réprouve et que l’administration coloniale feint d’ignorer. Les aristocrates profitant des largesses de l’administration pour acquérir des terres, engagent directement sur le port d’Alger ou d’Oran, un métayer parmi les nouveaux arrivants. Ces pauvres gens exploitent une terre dont ils ne tirent qu’un salaire de misère. Pour beaucoup d’entres eux, ils sont venus en Algérie avec l’espoir de chasser cette misère de leur vie, or, elle fait toujours partie de leur quotidien. Les aristocrates retournent en France et reviendront l’année suivante, après les récoltes, faire le tour de leur domaine en calèche et empocher les bénéfices. Quant aux riches propriétaires qui vivent en permanence sur ces nouvelles terres, ils reprochent aux commerçants juifs de pratiquer une concurrence déloyale en vendant leurs marchandises à bas prix et de consentir facilement des crédits aux petits colons qui, dans le bled, ont maille à partir avec les banquiers. Franz a confiance en l’avenir, il ne veut pas suivre le troupeau qui engraisse les gros propriétaires ; il veut tout simplement réussir.
A son retour d’Oran, il prévoit une halte de deux jours à Relizane. L’aubergiste de Tiaret lui a conseillé un maquignon chez qui il trouvera un bon cheval. Dans la remise, il y a une vieille charrette, le brancard et l’essieu semblent en bon état. Sur l’une des roues, un rayon est brisé. Le charron de Tiaret, avec qui Franz a conversé un moment, a promis de venir récupérer la roue et de la réparer pendant son absence. Quelques planches pour refaire la caisse et le tour est joué. Franz, en plus d’une maison, possède une charrette. Pour le moment tout va bien.
A Oran, il a déposé un dossier auprès de l’administration des domaines pour obtenir un prêt. D’après son banquier, il faut trois à quatre semaines pour que la somme arrive sur son compte, mais Franz n’est pas pressé et la proposition du banquier de lui faire une avance, avec intérêts bien entendu, ne le tente pas. Un courrier à l’adresse du relais-auberge de Tiaret est prévu pour l’avertir du virement. Maintenant que toutes ces formalités sont terminées, il peut enfin se consacrer à sa terre et à sa maison. La première diligence en partance est la bonne, de toute façon, les coches ne prennent pas de marchandises et dès que sa charrette sera réparée, il fera le voyage avec son nouvel attelage jusqu’à Mascara pour assurer lui-même le transport du matériel. Avec le développement de la vigne, Mascara est devenue une grande ville, bien achalandée, ce qui facilite la vie des colons à l’intérieur du pays. Reste malgré tout un problème à régler : le transport de son sac de semence et de la charrue. C’est le responsable du dépôt qui lui fournit la solution.
– Le problème est toujours le même ; alors je rachète la charrue que je revends avec un petit bénéfice. Vous, avec l’argent et avec une modeste rallonge, vous en achetez une autre chez le quincaillier du cercle, peut-être même que vous allez y gagner en trouvant une bonne occasion. Bien sûr, je n’ai pas le droit de procéder de la sorte ; mais c’est pour rendre service.
L’homme ressemble à une fouine. Très remuant, son visage au grand nez pointu et aux fines moustaches lui donne l’aspect de ce voleur de poulailler qu’est ce petit animal. Il propose, comme un service, une transaction illicite pour arrondir sa fin de mois. Qu’importe ! Franz est d’accord. Le coût du transport vers Tiaret est certainement plus onéreux que la perte de quelques sous.
– Eh bien ! Je suis d’accord. Votre solution me convient ; le fusil et le sac de semence sont facilement transportables. L’argent de la charrue aussi…
L’humour de Franz provoque un petit rire nerveux chez la fouine, ravi d’avoir fait une bonne affaire. Le cocher de la diligence est du même avis que le petit chef de dépôt. Il est fermement opposé au transport du sac de semence, transport qu’il accepte la mort dans l’âme après que Franz, qui a bien assimilé les coutumes locales, lui ait proposé un petit bakchich. Ce lointain héritage des Turcs a traversé les siècles et chaque service est ainsi monnayé, et à force de tractations, de compromis et de quelques pièces d’argent, il arrive enfin à Relizane. C’est la fin de la journée et il décide de passer la nuit dans l’auberge relais des postes.
Le jour filtre à travers les claires-voies de la fenêtre et vient frapper son visage. Franz entend les bruits de la rue… des éclats de rires arrivent de la grande salle de l’auberge. Il a un peu honte d’être resté aussi longtemps couché et cherche une excuse à fournir à l’aubergiste pour justifier sa « faute ». Les autres clients de l’auberge ont déjà avalé leur café depuis un moment ; ceux qui continuent leur route rangent leurs bagages près de la porte. Deux petites filles sont assises sur les sacs de voyages, les yeux grands ouverts, elles semblent perdues dans les derniers rêves de la nuit. L’aubergiste arrive avec un grand sourire :
– Il me reste encore du café cher monsieur ! Dit-il avec un petit air narquois.
– Merci !…Avec du pain et du miel si vous pouvez…
Franz ne s’aperçoit pas que les voyageurs quittent l’auberge, il est perdu dans ses pensées. Il a tant de chose à faire. Il se rend compte que le café est posé devant lui, il avait à peine remarqué la jeune mauresque qui l’avait servi.
– Pardon monsieur l’aubergiste ! Pouvez-vous m’indiquer où se trouve la jumenterie ; je dois acheter une monture pour travailler mes champs. Je me suis installé à Tiaret …
– Bien sûr ! Bien sûr ! C’est à l’extérieur de la ville, vous êtes passé devant en arrivant hier. Il y a beaucoup de trafic sur cette route et vous trouverai bien quelqu’un pour vous transporter.
Le maquignon que recherche Franz est connu dans la région ; il n’a donc aucune difficulté pour trouver la ferme en question : Blanc et Fils- Elevage et vente de chevaux. Il se présente à l’entrée de la jumenterie où un employé le guide vers une bâtisse en dur. Dans le bureau, qui ressemble à un guichet de banque, deux jeunes femmes européennes écrivent avec application. Absorbées par leur travail, elles ne quittent pas des yeux les pages des épais registres dont elles noircissent les pages de chiffres et de noms ; pages qu’elles épongent régulièrement avec une feuille de buvard. Un homme en gilet, les bras de chemise remontés au-dessus des coudes, s’affaire dans un meuble de rangement. Franz salut avec insistance pour attirer l’attention
– Bonjour ! C’est pour l’achat d’un cheval…
Les têtes se tournent vers le guichet, le regard accusateur pour avoir interrompu le travail en cours. L’homme aux manches retroussées trouve soudainement le sourire et s’approche du guichet.
– Bonjour cher Monsieur ! Je suis Julien Blanc…Le fils. C’est pour la monte ou pour le travail ?
– A vrai dire, c’est pour le travail des champs mais aussi pour la charrette…
– Je vois. Vous voulez une bête à tout faire. Venez ! Suivez-moi !
Franz suit le robuste personnage qui d’un bond se retrouve dans un petit cabriolet. Il invite son client à prendre place et les voici au trot sur une longue piste qui s’enfonce dans une allée bordée d’arbres.
– Vous savez, c’est la saison creuse pour nous. Les exploitants ont terminé leur récolte, c’est le moment pour nous de faire pouliner nos juments. Vous voyez l’enclos là-bas à droite des cyprès …J’ai ce qu’il vous faut.
De magnifiques spécimens de la race chevaline courent en toute liberté dans un espace immense. Les juments et leurs poulains galopent à pleine vitesse sur une distance très courte ; la mère entraînant son petit. Puis, la jument s’arrête net tandis que son poulain continue sa course folle et désordonnée en faisant des cabrioles pour changer de direction. Le spectacle fascine Franz, il en oublie le but de sa visite. Une magnifique bête, puissante, avec une robe grise, s’approche de la barrière. Curieuse, il semble qu’elle vienne saluer les visiteurs avec des hochements de tête accompagnés d’un souffle puissant qui s’échappe de ses naseaux. Franz lui caresse le museau…
– C’est une percheronne de deux ans, magnifique bête faite pour le labour. Intelligente et docile, elle aime aussi l’attelage ….
Franz n’entend plus le monologue du fils Blanc ; il voit cette superbe jument près de sa nouvelle demeure à Tiaret, travaillant avec son maître, tirant la charrue pour tracer les sillons d’une nouvelle existence.
– Combien vous dites ?
– Je n’ai encore rien dit ! Mais je dirai …Voyant …
Franz n’a pas discuté le prix qui lui semblait raisonnable. Pour la première fois de sa vie, il va régler un gros achat avec un chèque. Le banquier lui avait remis une liasse de ces documents à remplir, une manière moderne de payer ses achats avait-il répété à plusieurs reprises. L’équipage repart vers les bureaux avec la belle percheronne attachée à l’arrière de la carriole.
Voilà trois jours que Franz est sur les routes avec sa jument ; trois nuits qu’il dort à la belle étoile. Cela lui rappela le temps où il était jeune soldat lors de ses classes. Il parcourait la garrigue des journées entières avec sa section à l’instruction, usant les semelles de ses godillots sur les pistes caillouteuses entre Cassis et Marseille, dormant à la belle étoile, mangeant à la sauvette le maigre repas de l’Intendance. Il avait appris à doser ses efforts, à survivre sans le confort ordinaire…mais il avait avant tout découvert une nouvelle région avec ses senteurs, sa végétation, ses bruits, si différents de son pays natal. Son passage à Marseille avait totalement changé son existence; il était un homme avec déjà un passé douloureux qui découvrait une nouvelle vie. Le voici plongé dans les pages blanches d’un livre qu’il lui reste à écrire et dans un pays qu’il doit découvrir pour pouvoir s’y adapter.
Durant ces trois jours et ces trois nuits, ses pensées vagabondent au rythme du pas de sa puissante jument ; il est tantôt dans sa ferme à Tiaret, tantôt à Sidi Ferruch, tantôt à Sarreguemines…Il revoit l’image de la petite Emma, l’infirmière si dévouée qu’il avait connu à Alger. Une présence féminine lui manque terriblement ; quelqu’un avec qui partager sa nouvelle existence, une confidente, un soutien, la chaleur d’un amour partagé. Mais il doit attendre, il ne veut pas engager une femme et des enfants dans un échec ; il veut d’abord réussir dans l’entreprise qu’il s’est fixée. Il est certain de réussir mais il est aussi conscient qu’il ne maîtrise pas les éléments extérieurs, sa blessure au bras le lui rappelle parfois, c’est aussi un pays où les esprits s’échauffent rapidement.
 La Commune de Paris. Une barricade en mai 1871. Plus de 4200 communards seront déportés au bagne de Nouvelle-Calédonie. Ils auront comme compagnons de misère, les révoltés Kabyles de 1871.
La Commune de Paris. Une barricade en mai 1871. Plus de 4200 communards seront déportés au bagne de Nouvelle-Calédonie. Ils auront comme compagnons de misère, les révoltés Kabyles de 1871.
« La nuit approchait ; sombre et silencieuse, les vaincus d’Algérie et les vaincus de la Commune, assis côte à côte, pensaient à ceux qu’ils aimaient, à l’effondrement de leur existence, à l’anéantissement de leur rêve de liberté ».
Jean Allemane
Bagne de Toulon 1872
 Le général Virgile Antoine Schneider est un militaire et homme politique français, né le 22 mars 1779 à Sarreguemines (57), mort à Paris le 11 juillet 1847. Il fut ministre de la Guerre sous la Monarchie de Juillet dans le gouvernement Soult, du 12 mai 1839 au 1ier mars 1840.
Le général Virgile Antoine Schneider est un militaire et homme politique français, né le 22 mars 1779 à Sarreguemines (57), mort à Paris le 11 juillet 1847. Il fut ministre de la Guerre sous la Monarchie de Juillet dans le gouvernement Soult, du 12 mai 1839 au 1ier mars 1840.
Elu, le 21 juin 1834, député du 6° collège de la Moselle (Sarreguemines), réélu le 4 novembre 1837 et le 2 mars 1839.
Grand officier de la Légion d’Honneur en 1829, Grand-croix de la Légion d’Honneur en 1844, Grand commandeur de l’Ordre du Sauveur en 1831 (Grèce), Commandeur de l’Ordre royal de Léopold en 1835 (Belgique). Son nom est gravé sur l’Arc de Triomphe à Paris.
Lors de son passage au Ministère de la Guerre, il demanda au Maréchal Valée, gouverneur en Afrique du Nord, de nommer cette colonie « Algérie » dans toutes les correspondances. Voici le texte :
Monsieur le Maréchal,
Jusqu’à ce jour, le territoire que nous occupons dans le Nord de l’Afrique a été désigné dans les communications officielles, soit par le nom de Possession française dans le Nord de l’Afrique, soit sous celui d’Ancienne Régence d’Alger, soit enfin sous celui d’Algérie.
Cette dernière dénomination plus courte, plus simple et en même temps plus précise que toutes les autres, m’a semblé devoir dorénavant prévaloir. Elle se trouve d’ailleurs déjà consacrée par une application constante dans les documents distribués aux chambres législatives et dans plusieurs discours du trône. Je vous invite en conséquence à prescrire les mesures nécessaires pour que les diverses autorités, et généralement tous les agents qui, à titre quelconque se rattachant aux services civils et militaires de notre colonie, aussi dans leurs correspondances officielles et dans leurs actes ou certificats quelconques qu’ils peuvent être amenés à délivrer, à substituer le mot aux dénominations précédemment en usage.
Recevez, Monsieur le Maréchal, l’assurance de ma très haute considération.
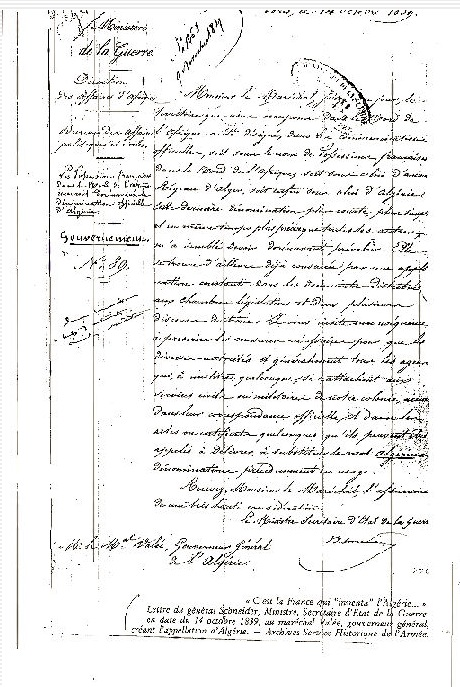 La colonie française du Nord de l’Afrique devient l’Algérie. C’est le nom arabe de la ville d’Alger, al-Djazä’ir, qui, francisé, va devenir Algérie.
La colonie française du Nord de l’Afrique devient l’Algérie. C’est le nom arabe de la ville d’Alger, al-Djazä’ir, qui, francisé, va devenir Algérie.
Déclaration des députés d’Alsace et de Lorraine.
Déclaration lue à l’Assemblée nationale de Bordeaux le 1ier mars 1871, par M. Jules Grosjean
Député et maire de Belfort.
Franz à sa sortie de l’hôpital d’Alger.
Il a vieilli, il est moustachu.
Son bras « à la napo » pour cacher son handicap.